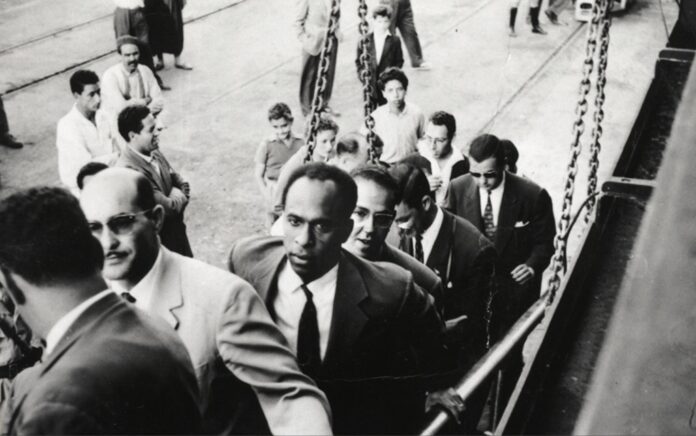Fanon et Cuba : la rencontre manquée
Les réserves de Fanon à l’égard de la Révolution cubaine prenaient leur source dans ce dédoublement de Fidel Castro à ses yeux. D’un côté, il était le leader d’un processus de libération nationale, qui récupérait une souveraineté perdue ou limitée, mais, de l’autre, un allié de Moscou, en pleine Guerre froide, qui faisait avancer les intérêts du bloc soviétique dans le Tiers-Monde.
Nous avons évoqué à plusieurs reprises le paradoxe selon lequel un penseur centenaire comme Frantz Fanon (1925-1961) – dont les idées ont profondément résonné avec la gauche radicale, nationaliste et anti-impérialiste, à la manière du Che Guevara — a exprimé, dans ses écrits entre 1959 et 1961 (année de sa mort), si peu d’enthousiasme pour la Révolution cubaine.
Sartre, par exemple – qui a rédigé la préface et, d’une certaine manière, a « traduit » Les Damnés de la Terre pour l’édition de François Maspero en 1961 — s’est davantage identifié à la Révolution cubaine que ne l’a fait le penseur noir, martiniquais et algérien. Même dans des textes postérieurs à 1959, comme ceux réunis dans Pour la révolution africaine (1964) – un livre malheureusement moins lu que d’autres –, Fanon parle de Cuba sans vraiment reconnaître les changements que la Révolution était en train d’opérer dans l’île et dans la région.
L’explication se trouve peut-être dans quelques passages des Damnés de la Terre, où Fanon évoque directement Fidel Castro. À un moment de son grand essai, il mentionne que les délégations du Tiers-Monde, réunies à l’ONU en septembre 1960, ne sont pas surprises de voir Castro en uniforme militaire à la tribune de l’Assemblée générale. Pour Fanon, il n’y a pas lieu de s’étonner de la tenue du dirigeant cubain, car la guerre est devenue, pour les pays sous-développés, un élément constitutif de leur réalité. La guerre n’est pas l’exception, mais la règle, le mode de vie des peuples colonisés, et l’uniforme symbolise cette origine et cette acceptation d’une réalité barbare :
« De même, Castro, se présentant à l’ONU en uniforme militaire, ne scandalise pas les pays sous-développés. Ce que montre Castro, c’est qu’il est conscient de l’existence d’un régime persistant de violence. Ce qui est étonnant, c’est qu’il ne soit pas entré à l’ONU avec sa mitrailleuse. Se seraient-ils peut-être opposés ? Les soulèvements, les actes désespérés, les groupes armés de couteaux ou de haches trouvent leur légitimité dans la lutte implacable entre capitalisme et socialisme. »
Mais Fanon n’ignorait pas que la polarisation de la Guerre froide avait produit un bloc communiste antagoniste, exerçant une hégémonie sur ses territoires – une hégémonie qui n’était pas non plus compatible avec les intérêts des nations colonisées du Tiers-Monde, notamment africaines. À l’instar de Che Guevara après 1962, Fanon fut critique envers Moscou et envers la politique des partis communistes européens, en particulier le Parti communiste français, dans leur approche de la question algérienne et de la décolonisation africaine en général.
C’est là que surgit la plus grande divergence entre Fanon et le projet cubain : pour l’intellectuel de la décolonisation, la logique binaire de la Guerre froide faisait partie intégrante de l’appareil politique et symbolique de l’ordre colonial. C’est pourquoi, dans un autre passage des Damnés de la Terre, il critique la protection nucléaire de Cuba par l’URSS, conçue dès 1960 par la direction cubaine :
« On ne peut pas affirmer que seule la démagogie explique le soudain intérêt des grandes puissances pour les petits problèmes des régions sous-développées. Chaque rébellion, chaque sédition dans le Tiers-Monde s’inscrit dans le cadre de la Guerre froide. Deux hommes sont battus à Salisbury, et tout un bloc s’agite, parle de ces hommes et, à partir de ce passage à tabac, pose la question particulière de la Rhodésie – la reliant à l’ensemble de l’Afrique et à tous les hommes colonisés. Mais l’autre bloc aussi mesure, par l’ampleur de la campagne menée, les faiblesses locales de son système. Les peuples colonisés se rendent compte qu’aucun camp ne se désintéresse des indigents locaux. Ils cessent de se limiter à leurs horizons régionaux, immergés qu’ils sont dans cette atmosphère d’agitation universelle. Lorsqu’on apprend tous les trois mois que la 6e ou la 7e flotte se dirige vers telle ou telle côte, lorsque Khrouchtchev menace de sauver Castro par les missiles, lorsque Kennedy, à propos du Laos, décide de recourir aux solutions extrêmes, le colonisé ou le nouvellement indépendant a l’impression d’être, de gré ou de force, entraîné dans une sorte de course effrénée. »
Les réserves de Fanon envers la Révolution cubaine trouvent donc leur origine dans cette dualité qu’il percevait chez Fidel Castro : d’un côté, Castro était le leader d’un processus de libération nationale, récupérant une souveraineté perdue ou limitée ; de l’autre, il était un allié de Moscou, promouvant les intérêts du bloc soviétique dans le Tiers-Monde.
Le premier Castro correspondait au projet de décolonisation auquel Fanon s’était engagé dès les années 1950, lorsqu’il s’installa, jeune psychiatre diplômé de Lyon, dans un hôpital psychiatrique en Algérie. Le second Castro, en revanche, s’inscrivait dans le système colonial de la Guerre froide, intégrant la politique globale du bloc soviétique et des partis communistes alignés sur Moscou et le marxisme-léninisme. [1]
La clé de la distance critique de Fanon vis-à-vis de la Révolution cubaine réside, comme chez E. P. Thompson et d’autres marxistes critiques de la Nouvelle Gauche, dans la conviction que l’alignement sur le bloc soviétique ôtait au socialisme cubain son originalité et l’empêchait de soutenir de manière autonome la décolonisation africaine.
On sait que, entre 1964 et 1965, Che Guevara tenta de réduire cette distance lors de ses périples africains. En plus d’un modèle spécifique de gestion de l’économie, différent du modèle soviétique – qui suscita de fortes résistances au sein du gouvernement –, Guevara transmit à la direction cubaine une stratégie complète d’intervention dans les processus de décolonisation en Afrique, allant de la diplomatie à la guérilla. Contrairement à son modèle économique, rapidement abandonné, la politique de soutien à la décolonisation africaine fut poursuivie jusqu’aux années 1980.
Entre fin 1964 et début 1965, Guevara visita l’Algérie, le Mali, le Congo, la Guinée, le Ghana, le Dahomey, la Tanzanie, et rencontra Ben Bella, Nasser, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Massamba-Débat, et même Agostinho Neto, nouveau leader du MPLA.
Lors d’un de ces voyages, il rencontra également Josie Fanon, la veuve du penseur martiniquais décédé à Washington quelques années plus tôt, et réaffirma, dans Révolution africaine (qu’elle dirigeait), des idées très proches de celles exprimées dans Les Damnés de la Terre.
L’implication de Guevara dans ces processus avait, au-delà de l’idéologie, une origine intellectuelle souvent négligée : il était peut-être le seul dirigeant cubain à parler et lire le français.
Dans les archives du Fondo de Cultura Económica à Mexico, on trouve plusieurs traces de son intérêt pour la traduction espagnole des Damnés de la Terre, avec la fameuse préface de Jean-Paul Sartre.
La traduction, comme on le sait, fut confiée par Enrique González Pedrero, collaborateur d’Orfila Reynal, à son épouse, l’écrivaine cubaine Julieta Campos. Le livre connut deux éditions : l’une en 1963, l’autre en 1965.
Dans les archives d’Orfila, on trouve des lettres de Carlos Fuentes et de González Pedrero faisant état de l’intérêt de Raúl Roa Kourí, fils du ministre cubain des Affaires étrangères, alors en poste à l’ambassade de Cuba au Mexique, pour envoyer des exemplaires de l’édition espagnole à La Havane.
Finalement, comme l’a noté Félix Valdés García, La maison d’édition Venceremos a reproduit la traduction des Damnés de la Terre en 1965, et les Éditions Révolutionnaires a réimprimé les essais de Pour la révolution africaine en 1966.
La connexion entre les guérillas latino-américaines et les mouvements de décolonisation en Afrique et en Asie, favorisée par la Révolution cubaine, fut en grande partie le point de départ de la création d’organisations comme l’OSPAAAL(Organisation de solidarité des peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine), qui tint sa première réunion à La Havane en janvier 1966.
Guevara, qui se trouvait alors reclus dans une résidence à Dar es-Salaam, après l’échec de la guérilla au Congo et dans l’attente d’un transfert vers Prague, vit dans la création de cet organisme une confirmation de ses idées.
Le Message de Guevara à la Tricontinentale, rendu public en avril 1967 alors qu’il combattait en Bolivie (bien qu’il ait été rédigé quelques mois auparavant), ne cite pas Fanon. Toutefois, dans son analyse de la situation africaine, il évoque une « virginité » du processus colonial africain, qui rappelle certains passages des Damnés de la Terre.
Guevara distinguait les avancées observées dans les processus de décolonisation des enclaves portugaises – Guinée-Bissau, Mozambique, Angola – des reculs constatés au Congo, en Rhodésie et en Afrique du Sud, avec son régime d’apartheid.
Mais, à l’instar de Fanon, il pressentait que la décolonisation ne suffisait pas à mettre fin à l’époque coloniale :
« On observe alors que le manichéisme primaire qui régissait la société coloniale se maintient intact durant la période de décolonisation. »
Ainsi, la réception limitée de Fanon à Cuba eut lieu au moment le plus clairement « guevariste » de la Révolution cubaine, entre 1966 et 1968.
Une fois cette phase guevariste dépassée, et après l’adoption d’une politique d’intégration au bloc soviétique, les idées de Fanon, critiques envers les « deux impérialismes de la Guerre froide » — dans la même veine que le discours de Guevara à Alger — devinrent un obstacle à la soviétisation du socialisme cubain.
Dans Lire Fanon 50 ans après (2016), le chercheur cubain Félix Valdés García affirme que, dès les années 1970, le penseur décolonisateur :
« a cessé de faire partie des lectures de philosophie à l’Université de La Havane ». [2]
Le Mexicain Jaime Ortega Reyna soutient, pour sa part, que :
« la pensée de Fanon a été largement oubliée à Cuba, en particulier son esprit décolonisateur ». [3]
Comme le suggère Ortega, le geste tardif de Roberto Fernández Retamar et d’autres, visant à intégrer Fanon dans la tradition révolutionnaire de José Martí, a eu pour effet de diluer la radicalité de la pensée fanonienne, en l’interprétant à travers le républicanisme martien.
Toute tentative d’approche de Fanon à partir de la tradition intellectuelle de la décolonisation hispano-américaine du XIXe siècle se heurte à la difficulté d’assimiler ce noyau républicain.
Et toute autre tentative, depuis le marxisme latino-américain de la Guerre froide, rencontre l’obstacle de la critique fanonienne des deux impérialismes – une critique que Guevara partageait.
On oublie – délibérément – un élément clé de ce désaccord : le 20 septembre 1973, lors d’une réunion du Mouvement des non-alignés à Alger, Fidel Castro proposa une réfutation du célèbre discours de Guevara, prononcé dans cette même ville une décennie auparavant.
Selon Castro, l’URSS n’était pas une puissance impérialiste, mais une nation solidaire, dont le soutien au Tiers-Monde était « ferme et profond ». Critiquer ce soutien, comme l’avaient fait certains leaders de la Nouvelle Gauche – Fanon et Guevara notamment – revenait, selon lui, à donner des armes au révisionnisme de gauche, complice de la guerre impérialiste. [4]
Dans The Rebel’s Clinic (2024), la brillante biographie de Frantz Fanon écrite par Adam Shatz, on trouve la confirmation du rejet éprouvé par le psychiatre et révolutionnaire martiniquais et algérien à l’égard de la logique de la Guerre froide, qui faisait de l’alliance avec le bloc soviétique la seule voie possible vers la décolonisation.
Son lien avec Holden Roberto, leader angolais anticommuniste, s’inscrit dans cette même hétérodoxie.
Le désaccord entre Fanon et Cuba n’était que le prolongement de son désaccord plus ancien avec le Parti communiste français et la gauche pro-soviétique européenne, qui, à ses yeux, ne pouvaient concevoir la décolonisation en dehors de la rationalité binaire de la Guerre froide.
Rafael Rojas
Traduction : Daniel Pinós
.
[1] Cf. Rafael Rojas, Fighting over Fidel. The New York Intellectuals and the Cuban Revolution, Princeton University Press, 2017.
[2] Félix Valdés García (éd.), Lire Fanon un demi-siècle plus tard, CLACSO / Ruth Editorial, Buenos Aires, 2017.
[3] Jaime Ortega Reyna, La révolution imaginée. Itinéraires de la réception de Frantz Fanon en Amérique latine et dans les Caraïbes, dans Mario Rufer, La colonialité et ses noms : concepts-clés, CLACSO, Buenos Aires, 2023.
[4] Cf. Claudia Zapata, Lucía Stecher et Elena Oliva, Frantz Fanon depuis l’Amérique latine : lectures contemporaines d’un penseur du XXe siècle, Corregidor, Buenos Aires, 2013.
[5] Adam Shatz, The Rebel’s Clinic. The Revolutionary Lives of Frantz Fanon, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2024.
Rafael Rojas (Santa Clara, Cuba, 1965) est historien et essayiste. Il est licencié en philosophie de l’Université de La Havane et docteur en histoire du Colegio de México. Il collabore régulièrement à la revue Letras Libres et au journal El País, et il est membre du comité de rédaction de la revue Istor du Centre de recherche et d’enseignement en économie (CIDE).
Depuis juillet 2019, il occupe le fauteuil n° 11 de l’Académie mexicaine d’histoire.