Cuba retrouve la mémoire
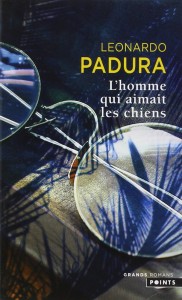 Le rapprochement historique entre Cuba et les Etats-Unis a brisé le socle de l’idéologie castriste, ce mélange d’anti-impérialisme et d’antiaméricanisme. « Le nationalisme défensif, le syndrome de la forteresse assiégée ne peuvent plus justifier l’autoritarisme du régime cubain », affirme l’historien Manuel Cuesta Morua, opposant social-démocrate rencontré à La Havane. Derrière cette rupture, une autre révolution se profile : la libération de la parole et celle de la mémoire.
Le rapprochement historique entre Cuba et les Etats-Unis a brisé le socle de l’idéologie castriste, ce mélange d’anti-impérialisme et d’antiaméricanisme. « Le nationalisme défensif, le syndrome de la forteresse assiégée ne peuvent plus justifier l’autoritarisme du régime cubain », affirme l’historien Manuel Cuesta Morua, opposant social-démocrate rencontré à La Havane. Derrière cette rupture, une autre révolution se profile : la libération de la parole et celle de la mémoire.
L’écrivain Leonardo Padura, Prix Princesse des Asturies 2015, auteur du roman L’Homme qui aimait les chiens (Métailié, 2011, rééd. Points, 2014), a eu le sentiment de se « réveiller d’un interminable cauchemar », confiait-il dans un article sur l’impact du dégel publié dans Le Monde du 21 janvier. Grâce au roman de Padura, les lecteurs cubains ont découvert que l’assassin de Léon Trotski, après avoir purgé sa peine à Mexico, avait coulé des jours tranquilles à La Havane, à la suite d’un échange de bons procédés avec Moscou, commanditaire du meurtre.
Ce n’est pas la seule révélation qui attend les Cubains : leur histoire récente regorge de secrets et de tabous. La révolution de Fidel Castro (1959) a débouché sur un « récit national » orchestré par le parti unique. « Du passé faisons table rase » : seuls méritaient d’être sauvés les figures et moments présentés comme des antécédents de la geste castriste. La formation du parti unique ne s’est pas faite sans soubresauts ni purges, mais les ressentiments ont été refoulés au nom de la loyauté au « Lider Maximo ».
Pendant longtemps, l’écran officiel a occulté les mémoires brimées, minoritaires ou dissidentes. Aujourd’hui, même si, dans une sorte de course contre la montre biologique, Fidel et Raul Castro, 89 et 84 ans respectivement, risquent d’enterrer tous leurs vieux contempteurs, la mémoire se fraye un chemin. Ce n’est pas la vieille génération qui expose ses versions ou doléances, mais la jeunesse qui s’affranchit du récit officiel et retrouve certains pans d’un passé renié.
Il arrive que ce retour du refoulé soit une affaire de famille. L’essayiste Ambrosio Fornet avait forgé l’expression « quinquennat gris » pour dénoncer la mise au pas de la culture pendant les années 1970. Son fils, l’universitaire Jorge Fornet, revisite la poussée d’intolérance autour de l’« affaire Padilla », l’autocritique publique à laquelle avait dû se livrer le poète Heberto Padilla (1971 : Anatomie d’une crise, 2014, non traduit). Poursuivi pour avoir critiqué le gouvernement, traité de dissident sournois, Padilla fut contraint de s’exiler. A l’époque, une bonne part de l’intelligentsia occidentale, initialement attirée par le castrisme, avait pris ses distances, tandis que les créateurs cubains étaient sommés de rentrer dans le rang sous peine d’être ostracisés.
Remontant encore dans le temps, les jeunes chercheurs Elizabeth Mirabal et Carlos Velazco sont partis « A la recherche de Cain » (Buscando a Cain, 2013, non traduit), un des noms de plume de l’écrivain Guillermo Cabrera Infante (1929-2005), bête noire du régime dont l’existence avait été effacée des encyclopédies cubaines.
L’auteur avait pourtant dirigé le supplément culturel du quotidien Revolucion (1959-1961), fleuron de la presse castriste des premiers temps, et signé en 1967 un des ouvrages les plus remarquables du boom du roman latino-américain, Trois tristes tigres(Gallimard, 1970). Mais pour avoir manifesté son opposition au tournant pro-soviétique du régime, il fut contraint à l’exil en 1965.
Les chercheurs Mirabal et Velazco privilégient les témoignages, avant que les acteurs ne disparaissent. Il y a une sorte de justice poétique dans cette réhabilitation posthume de Cabrera Infante, immense écrivain couronné par le prestigieux prix Cervantes en 1997 : l’auteur de Trois tristes tigres avait élaboré une polyphonie littéraire pour évoquer la bohème pré-révolutionnaire, jouant avec les accents et les expressions des noctambules de La Havane.
Ce travail de mémoire ne se limite pas au strict domaine de la culture. Le dégel est plus général. Dans son documentaire « Les Feintes de Saturne » (Los Amagos de Saturno, 2014), une jeune journaliste et réalisatrice, Rosario Alfonso Parodi, s’en est ainsi prise à un sujet autrement sulfureux : le « cas Marquitos ». Marcos Rodriguez, dit « Marquitos », fut jugé et condamné à mort, en 1964, pour une affaire vieille de plusieurs années. Il était accusé d’avoir livré à la police les informations menant à une descente meurtrière contre une planque de la résistance à la dictature de Batista (1952-1958). L’affaire déchira les milieux proches du pouvoir castriste et, cinquante ans après, les minutes du procès sont toujours gardées secrètes.
Selon certains, la sentence masquait un règlement de comptes avec l’ancien parti communiste, le Parti socialiste populaire (PSP), opposé à la lutte armée, dont Marquitos était très proche. Le jeune homme fut interrogé personnellement par Fidel Castro, qui le persuada de plaider coupable avant de le faire exécuter. Un quart de siècle plus tard, l’histoire se répétera pour le général Arnaldo Ochoa, héros de la guerre d’Angola, fusillé avec d’autres officiers en 1989. Saturne a continué à dévorer ses enfants.
Jusqu’à présent, seul le journaliste espagnol Miguel Barroso avait osé plonger dans cet imbroglio emblématique, avec le livre « Une affaire sensible » (Un asunto sensible, Barcelone, 2009, non traduit). Dans son blog « La pupille insomniaque », l’essayiste Juan Antonio Garcia Borrero souligne la volonté de jeunes réalisateurs, comme Rosario Alfonso Parodi, de « plonger dans les abîmes de l’histoire ». Alors qu’il travaille lui-même sur une biographie du cinéaste Tomas Gutiérrez Alea (1928-1996), l’auteur du film Fraise et chocolat, nommé aux Oscars en 1995, le blogueur a été surpris par la quantité de matériaux inconnus datant de la période pré-révolutionnaire. Au point d’envisager un premier tome consacré aux années de formation du réalisateur.
Peu à peu, les tabous se fissurent. Comme celui concernant le prix, en vies et en traumatismes, de l’intervention militaire cubaine en Afrique. Le premier film à essayer de faire parler les anciens combattants, Cartas de Angola (« Lettres d’Angola », 2011), a été réalisé par une Portugaise, Dulce Fernandes, ancienne élève de l’Ecole internationale de cinéma de San Antonio de los Baños (province de La Havane).
Dans un recueil de contes, Aquello estaba deseando ocurrir (2015, en cours de traduction), Padura évoque le corps expéditionnaire cubain dans la guerre civile en Angola (1975-1991). Un demi-million de Cubains sont passés par là, et les personnages de Padura en restent blessés à jamais dans leurs souvenirs. A propos de Retour à Ithaque, film de Laurent Cantet réalisé d’après un récit de Leonardo Padura sur les blessures d’une génération sacrifiée, Garcia Borrero distingue la mémoire officielle et la « mémoire affective » ou individuelle des créateurs.
Ces chercheurs et auteurs semblent découvrir une scène primitive permettant de mieux comprendre l’évolution ultérieure, comme si la vraie nature de Cuba avait été ensevelie par un demi-siècle d’idéologie. Géologues autant qu’historiens, ils explorent les couches successives du récit national. Pendant des décennies, les exilés avaient eu la primeur des révisions historiques. Désormais, les approches des Cubains résidant dans l’île et des expatriés convergent.
Loin de mettre un baume sur des blessures béantes, l’arrogance du discours castriste a exacerbé les souvenirs et prolongé les drames. Les milliers de fusillés, les dizaines de milliers de prisonniers, les deux millions d’expatriés (un Cubain sur cinq), les innombrables individus brimés, licenciés, expropriés ou ostracisés constituent autant d’histoires tragiques qui exigent d’être racontées et écoutées. Avant d’envisager justice ou réparation pour les victimes, le besoin de vérité s’impose. L’effondrement du récit castriste ouvre la voie à une multiplication des récits, des analyses, des opinions. Après un demi-siècle d’apparent unanimisme et d’égalitarisme par le bas, les Cubains vont découvrir à quel point ils sont différents, pluriels. Cela risque d’être douloureux.
Paulo A. Paranagua
America latina VO
