« Paradiso » de José Lezama Lima – initiation au déchiffrement du monde
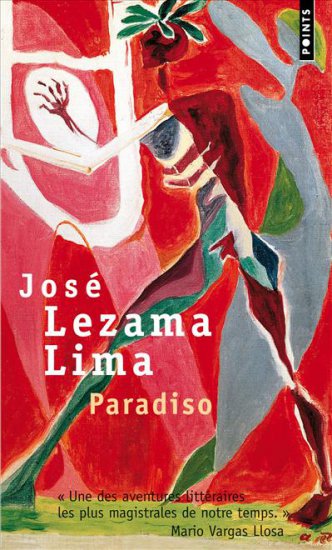 José Lezama Lima, poète, critique et romancier, est souvent désigné comme le « Proust cubain ». Un tel rapprochement se fait à la faveur de son premier roman Paradiso, incontournable de la littérature de son pays quoique censuré dès sa publication. En réalité, premier et dernier, de son vivant du moins, car ne paraîtra qu’après sa mort la suite de Paradiso, Oppiano Licario, œuvre inachevée. Auteur à œuvre unique, mis à part ses poèmes et ses articles dans les revues culturelles cubaines, qui brassent les littératures étrangères, il déploie dans ce roman innervé d’autobiographie, dans lequel le « je » surgit parfois à la place du « il », toute une perception du monde, profondément poétique. Imprégné par l’hermétisme mallarméen, il ne propose pas tant des phrases longues qu’une langue compliquée, à apprivoiser au long des 600 pages – épreuve nécessaire à une initiation au déchiffrement du monde pour le lecteur.
José Lezama Lima, poète, critique et romancier, est souvent désigné comme le « Proust cubain ». Un tel rapprochement se fait à la faveur de son premier roman Paradiso, incontournable de la littérature de son pays quoique censuré dès sa publication. En réalité, premier et dernier, de son vivant du moins, car ne paraîtra qu’après sa mort la suite de Paradiso, Oppiano Licario, œuvre inachevée. Auteur à œuvre unique, mis à part ses poèmes et ses articles dans les revues culturelles cubaines, qui brassent les littératures étrangères, il déploie dans ce roman innervé d’autobiographie, dans lequel le « je » surgit parfois à la place du « il », toute une perception du monde, profondément poétique. Imprégné par l’hermétisme mallarméen, il ne propose pas tant des phrases longues qu’une langue compliquée, à apprivoiser au long des 600 pages – épreuve nécessaire à une initiation au déchiffrement du monde pour le lecteur.
Il n’y a pas véritablement d’intrigue dans Paradiso. Le seul point stable, le fil rouge qui parfois se rompt ou se perd avant de servir à renouer des morceaux épars, est le personnage José Cemí – appellation dans laquelle il faut lire la filiation avec l’auteur par le prénom, et le motif central du signe par le nom. La vie de José Cemí est en effet reconstituée de son enfance à son entrée dans l’âge adulte, mais par mille détours et digressions, dont on comprend peu à peu qu’elles servent l’appréhension de sa vie. Après quatre chapitres consacrés à son enfance, une analepse invite à découvrir sa généalogie, par les vies de ses parents et de son oncle Alberto, multiples reflets de la sienne, chargées de prémonitions. D’une génération à l’autre, c’est la fin d’un monde qui est en jeu – une chute du paradis seulement compensée par l’acquisition de la connaissance, du savoir. Ce monde dont il ne reste plus que des vestiges est celui de la noblesse de Cuba, qui perd peu à peu sa fortune, mais pire encore son destin, au point d’être ramenée à la banalité. José Cemí le premier aura donc à s’affirmer, mais c’est selon un de ses amis dans cette affirmation que se distinguent précisément les meilleurs.
A l’histoire familiale qui prend les allures d’une mythologie, une mythologie érodée par le temps, s’ensuit la jeunesse de José Cemí, déterminée et construite par tout ce qui le précède. Le récit de ses études à l’université et de ses amitiés entraînent encore vers des dérives à la poursuite des aventures ses acolytes Foción et Fronesis. Mais même d’autres vies plus éloignées du personnage principal s’invitent parfois, au cours de chapitres qui montent en parallèle des destinées éphémères qui se rejoignent pour un instant seulement ou plus par la grâce du hasard. Le tout avec Cuba en arrière-plan, sa musique, ses flamboyants, sa Santeria, le Malecón et les rues du Vedado, les patios de ses maisons, ses soirées chaudes…
Quoique la biographie sous-tende l’ensemble de l’œuvre, la composition est ainsi loin d’être linéaire. Elle s’apparente davantage à un ciel illuminé de quelques constellations, qui chacune offrent des centres différents. Une fois l’une d’entre elles explorée, elle paraît abandonnée dans le passage d’un chapitre à l’autre, qui chaque fois introduit une rupture nette, sollicite un déplacement, une remise en jeu de la logique développée. Mais dans cet ensemble, des motifs, comme en musique, tissent la mélodie. Ainsi la maladie, et plus particulièrement l’asthme, qui ouvre l’œuvre dans une nuit cauchemardesque hantée par la mort, dont l’angoisse est mise en contrepoint par la panique comique des domestiques. Egalement, le temps, sa perception, et plus encore les tentatives pour se l’approprier, pour contrer la mort. Celle-ci revient régulièrement, au point de former une collection de morts, toutes plus spectaculaires et tragiques les unes que les autres car mises au contact de la fête, l’insouciance tournant au drame. Pour échapper à la finitude, il y a l’éros, les relations sexuelles, et leurs frottements ambigus avec les relations amicales, et les joutes oratoires, les discours, les exercices de l’esprit, les débats philosophiques. Ces derniers sont les manifestations les plus spectaculaires de l’érudition qui traverse toute l’œuvre, incarnée par plusieurs figures débordantes de culture, d’autant plus impressionnantes qu’elles ne servent aucun but.
Si le savoir depuis Pythagore tient un rôle si central – au point de mêler au roman la poésie, la théologie, l’esthétique, la philosophie, l’histoire… –, c’est que le monde est appréhendé comme un ensemble de signes à déchiffrer. La clé est livrée par Oppiano Licario – celui qui donnera son nom à la suite de Paradiso –, au détour d’une conversation dans un omnibus : « La vie est un réseau de situations indéterminées ; chaque coïncidence est quelque chose qui veut parler à côté de nous ; si nous l’interprétons, nous assimilons une forme, nous donnons corps à la transparence ». Et encore poursuit-il : « Tout ce qui m’intéresse, c’est la coïncidence de mon moi dans la diversité des situations. Si je laisse passer de telles coïncidences, je me sens mourir ; quand je les interprète, je suis l’artisan du miracle, j’ai dominé l’acte informe de la nature ».
Tel sera donc le programme poétique de José Cemí à sa suite, et plus encore celui de Lezama Lima avant eux. Pour l’auteur comme pour ses personnages, il s’agit d’appréhender le réel comme une somme de signes à interpréter, comme un texte aux coïncidences secrètes à dégager, comme une forêt de symboles auxquelles prêter l’oreille. Une attention toute particulière est ainsi prêtée au monde, un monde qui prend des allures magiques, versé d’imaginaire, auréolé de mystère par le regard porté sur lui. Celui-ci est manifesté par les comparaisons, les métaphores, les adjectifs et les verbes impropres, qui viennent servir les interprétations symboliques de chaque nom, chaque geste, chaque événement. La moindre réalité, jusqu’à la plus triviale, est ainsi stylisée par le prisme poétique qui lui est appliqué, et les faits décomposés à l’infini passent à l’arrière-plan. Toute description devient la manifestation d’une subjectivité, l’écho d’une substance de rêve, l’expression d’un logos poétique.
Ce style, qui fait la matière même de l’œuvre, invite à son tour le lecteur à déchiffrer, aussi difficile cela puisse-t-il d’abord paraître. Chaque mot contient une épaisseur de sens ; pour chaque phrase, chaque épisode, il faut dépasser la densité pour traquer la nécessité, la synthèse et la présence. Saisir le monde de l’œuvre comme une totalité, un système, afin de reconstituer le destin de José Cemí au travers des événements et des images, du labyrinthe qu’ils finissent par former. Ainsi, la fin ne se présente pas comme une ressaisie totale et pleine mais comme un nouveau mystère à décrypter. Au lecteur, lentement initié par l’œuvre, ses personnages, son écriture, de révéler lui-même les correspondances. Et le roman prend alors la forme d’une initiation poétique, aussi bien dans la lecture de l’œuvre que dans celle du monde.
F.
