Canek Sánchez Guevara : l’indocile héritier
Anarchiste, écrivain, punk, photographe ou graphiste : bien des mots pourraient décrire Canek Sánchez Guevara. Si son tempérament et son goût pour le voyage rappellent son légendaire grand-père, l’homme n’a jamais voulu qu’on le considère comme « le petit-fils du Che » : impossible, répétait-il, d’incarner ce pantin exemplaire tant attendu par le régime. Il choisit dès lors de s’éloigner de Cuba, en quête d’anonymat.
Fils de la Péruvienne Hilda Guevara Gadea, aînée du premier mariage du Che, et d’Alberto Sánchez Hernández, un communiste mexicain réfugié à Cuba, Canek — « serpent noir », en langue maya — naît en 1974 dans une maison havanaise du quartier de Miramar. La petite famille voyage beaucoup : entourée de réfugiés politiques et d’activistes locaux, elle s’installe à Milan, Barcelone et Mexico pour finalement rentrer à Cuba. Canek y reste jusqu’à la mort de sa mère ; il a alors 22 ans et décide d’abandonner l’île pour rejoindre la ville d’Oaxaca, au Mexique. « En marge de tout principe politico-idéologique, il y a deux choses que j’admire grandement chez Ernesto Guevara : son internationalisme et sa témérité, desquels je me suis sans doute nourri », dira-t-il en 2012, au cours d’une interview pour le quotidien brésilien La Folha de Sao Paulo.
« Je trouve gênant un certain type de guévaristes, plus proches de la rhétorique chrétienne que de l’implacable athéisme du vieux guérillero. »
Mais nous sommes en 1986 et voilà vingt ans que ledit Guevara est mort. Le guérillero argentin n’est plus seulement un personnage historique mais un mythe révolutionnaire mondialement connu, une figure légendaire que le gouvernement cubain continue de célébrer. Dès l’enfance, Canek s’est rendu compte qu’être le descendant du Che impliquait une grande responsabilité. À son arrivée sur l’île, on exigea de lui un comportement digne de son grand-père ; on lui expliqua « comment [se] conduire, ce qu’il doit faire et ne pas faire, ce qu’il doit dire et ce qu’il doit taire ». Les barbudos au pouvoir aspiraient à le hisser sur quelque piédestal afin que le peuple pût contempler à travers le jeune héritier l’esprit du héros défunt. Mais Canek refuse en grandissant de devenir cette idole de propagande : « Être le petit-fils du Che
fut extrêmement difficile ; j’avais l’habitude d’être moi-même, rien d’autre. Je n’étais qu’un crado
de plus, un désaffecté
, un antisocial
et je me rapprochais beaucoup — selon les archétypes policiers — d’un lumpen. » Il souhaite seulement vivre sans avoir à porter la charge de son ascendance, sans devoir adapter son comportement aux injonctions officielles. Rébellion d’adolescence, disent d’aucuns. Canek exaspère l’oligarchie cubaine, en plus de ses parents. « Considéré comme un pestiféré par la plupart des soumis à Fidel et compagnie, qui lui ont tourné le dos de la façon la plus abjecte pour avoir été courageux dès son plus jeune âge, il dénonçait sans hésiter les aventures tout sauf révolutionnaires de ceux qui abandonnèrent son grand-père », expliquera son cousin, Martin Guevara, dans une lettre publiée en 2015 (1).
Mais le détachement n’est pas total. Canek désire uniquement s’éloigner de ceux qui cherchent à instrumentaliser les actes et les idéaux de son aïeul. Loin de refuser d’évoquer le Che, il collabore avec Radamés Molina Montes à une édition commentée de son Journal de Bolivie. Et justifie sa mise à l’écart volontaire par une défiance à l’endroit des dogmes et des simplifications — ce manichéisme propre au traitement des figures révolutionnaires modernes, en somme. « Je trouve gênant un certain type de guévaristes, plus proches de la rhétorique chrétienne que de l’implacable athéisme du vieux guérillero. Sa diabolisation me dérange tout autant, celle qui le présente comme un criminel sanguinaire jubilant dès qu’il fusille », écrira ainsi Canek dans son Journal sans motocyclette — un titre en écho, bien sûr, au Voyage à motocyclette du Che.
Une nouvelle bourgeoisie et un socialisme d’État
« La Révolution cubaine n’a pas été démocratique puisqu’elle a engendré les classes sociales qui l’en ont empêché : la révolution a enfanté une bourgeoisie, un appareil répressif prêt à la défendre du peuple et une bureaucratie pour l’éloigner de ce dernier. Mais, avant tout, elle a été antidémocratique en raison du messianisme religieux de son leader », ira-t-il jusqu’à dire. Fort de son patronyme, Canek connaît les fils et les filles des grandes familles de la bourgeoisie. Si ce mot sonne comme une insulte à Cuba, il n’en est d’autres pour désigner une classe sociale qui existe bel et bien. Seulement, Canek « ne vi[t] pas enfermé dans une petite bulle de cristal » ; il fréquente les fortunés autant que les plus humbles. C’est par la diversité de ses amitiés qu’il en arrive à la conclusion que la société cubaine demeure une société de classes : « Je commençais à comprendre que Peuple est une belle abstraction aux multiples usages, surtout rhétoriques… », expliquera-t-il. Canek critique le système politique cubain mais ne s’attaque pas au corpus idéologique dans lequel celui-ci assure puiser : le petit-fils dénonce simplement la contradiction qu’il constate entre le discours officiel et la réalité sociale, les idéaux communistes et le mode de gouvernement castriste. Propagande, censure, répression et inégalités font partie de la vie quotidienne à Cuba : elles ont à ses yeux peu à voir avec la théorie marxiste.
« Propagande, censure, répression et inégalités font partie de la vie quotidienne à Cuba : elles ont à ses yeux peu à voir avec la théorie marxiste. »
Fidel Castro et son armée de barbudos ont débarrassé l’île de l’impérialisme nord-américain, c’est un fait, mais l’instauration d’un État soi-disant « socialiste » a vu l’élan émancipateur amorcé par les révolutionnaires s’enliser. Dans une interview accordée au magazine Proceso, Canek expliquera que « tous [ses] reproches visant Fidel Castro et ses épigones proviennent de leur éloignement des idéaux libertaires, de leur trahison du peuple de Cuba et de l’affreuse surveillance mise en place pour préserver l’État par-dessus son peuple
». La ressemblance entre l’analyse formulée par Canek Sánchez Guevara et la critique du bolchevisme produite en son temps par l’anarcho-syndicaliste Rudolf Rocker saute aux yeux. « Sous la dictature du prolétariat
s’est effectivement développée en Russie une nouvelle classe, celle des membres de cette commissariocratie que la majorité de la population considère et subit aujourd’hui comme d’aussi évidents oppresseurs qu’autrefois les représentants de l’ancien régime. […] Ils ont accaparé les meilleurs logements et sont abondamment pourvus de tout, tandis que la grande masse du peuple continue à souffrir de la faim et d’une terrible misère », écrivait en effet Rocker dans Les Soviets trahis par les bolcheviks, au lendemain de la révolte matée de Kronstadt, en 1921. Les bolcheviks et les guérilleros, une fois parvenus au pouvoir, ont fini par ressembler à la bourgeoisie qu’ils avaient pourtant renversée…
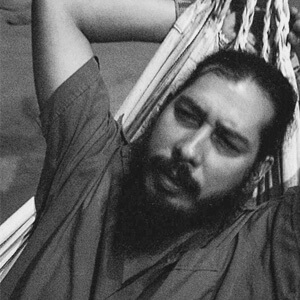 Un punk à Cuba
Un punk à Cuba
Lors d’une émission consacrée au punk cubain, le journaliste Rafael Uzcátegui fera savoir que le groupe Rotura, dont fit partie Canek, « était connu pour être un des premiers groupes punk sur l’île », à une époque où « le rock en général et le punk en particulier étaient proscrits, et alors qu’on savait que plusieurs rockeurs avaient été arrêtés pour le prétendu délit de dangerosité sociale
». Ce mouvement musical, porté par une frange de la jeunesse cubaine, se constitua avant tout autour du rejet de la culture officielle. Un moyen d’exprimer son refus de l’uniformité « socialiste » face à un gouvernement les décrivant comme autant de « jeunes aliénés par l’impérialisme qui voulaient détruire les institutions de l’île ». Rien moins. Canek dépeindra cette contre-culture bouillonnante dans 33 révolutions, avec l’ironie et l’autodérision dont faisaient preuve les « frikis » — déformation de « freaks », en espagnol —, ces punks ados de la Havane qui se surnommaient « l’Étron, le Boiteux et le Borgne » et écoutaient « el Miclláguer, el Lenon, el Santana, el Aironmaiden ».
Un unique livre
Canek écrit régulièrement pour des revues littéraires, comme Replicante, Letras Explícitas ou Letras Libres. De 2008 à 2012, pour le journal mexicain Milenio et Le Nouvel Observateur, il tient une chronique sur ses pérégrinations en Europe et en Amérique du Sud (2). 33 révolutions est son unique roman, publié à titre posthume à l’initiative de son père, Jesús Alberto Sánchez Hernández, qui disait de lui « qu’il n’était pas intéressé par la gloire, [qu’]il ne prétendait pas écrire des livres sensationnels ». 33 révolutions, comme les tours d’un vinyle : « Le pays entier est un disque rayé (tout se répète : chaque jour est une répétition de l’antérieur, chaque semaine, mois, année ; et de répétition en répétition le son se dégrade jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un vague et méconnaissable souvenir du son original — la musique disparaît, la remplace un murmure sablonneux incompréhensible). »
Le disque de Canek Sánchez Guevara s’est arrêté de tourner le 21 janvier 2015 à Mexico. Inconnu du grand public par volonté propre et briseur de destin : il réussit à devenir beaucoup plus que le petit-fils du Che.
Marti Blancho
Revue Ballast
Canek Sánchez Guevara, 33 révolutions, éditions Métailié, 2016, 90 pages
_______________
1. Sur le site Café Fuerte.
2. Voir le recueil Journal sans motocyclette, uniquement publié en espagnol aux éditions Pepitas de Calabaza.
__________________________________________________________________________________________________________________
Nous reproduisons ci-dessous l’entretien que Canek Sánchez Guevara accorda à notre compagnon Daniel Pinós et au Monde libertaire en novembre 2005 :
ENTRETIEN AVEC LE PETIT-FILS DE CHE GUEVARA
« Je devais donner l’exemple, mais moi j’ai toujours été rebelle… »
Le cigare cubain en main, la barbe mal implantée, la chevelure brune, de bonne stature, Canek est le petit-fils de Che Guevara, le fils d’Hildita Guevara, la première fille du guérillero argentin et cubain. Résidant aujourd’hui au Mexique, Canek fait partie des « enfants rebelles de la révolution », il est membre du MLC (Mouvement libertaire cubain). Dans cet entretien, il exprime son point de vue sur Fidel Castro, le « Vieux », sur la révolution cubaine, et le rejet que celle-ci lui inspire. Son témoignage met en évidence son besoin de rompre avec les mythes de la révolution, qui auront bercé son enfance et son adolescence. Pour Canek, la révolution cubaine n’est qu’un vulgaire capitalisme d’État. Elle a accouché d’une bourgeoisie d’État qui use aujourd’hui des organes répressifs d’une dictature pour maintenir ses privilèges. La révolution a été étouffée par sa bureaucratie, par la corruption, par le népotisme et la verticalité.
Canek dévoile pour nous ce qu’est la criminalisation de la différence à Cuba, les persécutions contre ceux qui refusent la culture officielle et préfèrent vivre aux marges de la société : homosexuels, punks, libres-penseurs, syndicalistes et poètes…
Cet anarchiste hétérodoxe a une vision très personnelle du rôle que doivent jouer les libertaires pour parvenir à libérer Cuba de la bourgeoisie socialiste. Nous devons comprendre son réalisme et la nécessité qu’il ressent de rompre avec certains schémas libertaires, si peu adaptés à une transformation sociale sur la grande île des Caraïbes.
Ses opinions, son récit sur ce qu’est une éducation cubaine, son regard les yeux fixés sur le rétroviseur de son existence à Cuba, où s’est accomplie une partie du destin de sa famille, font de cet entretien un témoignage unique devant définitivement nous permettre de jeter le mythe de Fidel Castro et de la révolution tropicale aux poubelles de l’histoire.
Pourquoi vis-tu aujourd’hui au Mexique ?
Mon père est mexicain, ma mère l’était aussi. J’ai fait mes études primaires au Mexique. À partir du moment où j’ai ressenti la nécessité de quitter Cuba, la première option pour vivre à l’extérieur de l’île fut le Mexique. Pour des questions administratives essentiellement, car j’ai des papiers mexicains et je n’avais ainsi pas à faire de demande pour un permis de résidence ou un permis de travail.
Je voulais comparer tout ce que j’avais étudié à Cuba avec la réalité mexicaine, relire l’histoire cubaine. Non pas l’histoire officielle que l’on m’avait enseigné. J’avais besoin de lire un grand nombre de choses interdites sur l’île. J’avais besoin d’une participation que je n’avais pu avoir à Cuba, où l’on nie les citoyens. Ne serait-ce qu’au niveau du quotidien, sans parler de participation aux grands événements, aux grandes discussions transcendantales, aux grands projets. L’exercice de la citoyenneté est la première chose interdite à Cuba. J’ai été attaqué alors par certains secteurs de la gauche pour mes prises de position par rapport à l’île. Ces gens considèrent que si tu n’es pas avec la révolution cubaine, tu es contre elle.
De toute façon ce n’est pas l’indisposition à la critique des militants de gauche qui me faisait peur. Mais j’avais besoin de penser autrement, de participer au débat sans passer pour un homme de droite. Je voulais que les choses soient claires, ce qui n’est pas facile pour cette gauche très fermée. Quand je suis parti de Cuba, je n’étais pas capable de me situer. Je vivais un rejet viscéral et total…
Dans cet entretien, tu fais référence à ton grand-père Ernesto Guevara de la Serna. Aujourd’hui, que représente-t-il pour toi, alors qu’il est devenu un mythe ?
Cette image du révolutionnaire pur, sans tache que l’on reproduit, aujourd’hui dans la gauche, est une simplification. De même qu’il est grotesque de dire qu’il était un criminel international, comme le font les anti-communistes radicaux. Le Che était beaucoup plus que ça et c’était un homme qui s’est dédié pleinement aux idées qu’il défendait, dans une sorte de recherche personnelle. Je l’admire, même si j’ai un désaccord profond avec ses idées sur les « foyers révolutionnaires » et l’« l’homme nouveau » (1), mais je ne peux les juger qu’à partir de la perspective actuelle. Si aujourd’hui quelqu’un vient et me dit : « nous allons créer une guérilla et faire la révolution », je l’envoie balader. Son expérience en Bolivie a malheureusement montré au Che, qu’il ne suffisait pas de créer un « foyer révolutionnaire » pour que la révolution éclate. Je suis guévariste, parce que Ernesto Guevara était un homme qui respectait ses engagements. Il a commis des erreurs en apportant son appui à une révolution qui se transforma en dictature. Je ne peux pas renier Che Guevara en raison du fait que je ne partage pas toutes ses idées. Je ne désire pas non plus lui ressembler. Cela me rappelle la manière dont on embrigadait les enfants, avec des slogans à Cuba : « Pionniers pour le communisme ! Nous serons comme le Che ! ».
 Je ne pense pas à Ernesto Guevara comme s’il s’agissait de mon grand-père.
Je ne pense pas à Ernesto Guevara comme s’il s’agissait de mon grand-père.
Je le lis comme je lis Marx ou Bakounine ou un quelconque autre personnage historique. Il a des idées géniales et d’autres qui sont absurdes, prétentieuses et pathétiques. Je ne l’ai pas connu, je suis né sept ans après son assassinat. Ma mère me racontait certaines anecdotes de son enfance qui font qu’un lien familial profond s’est noué. À cette époque, j’ai grandi au contact de gens qui admiraient profondément le Che.
J’imagine que dans la mesure où tu étais le petit-fils du Che, durant toutes les années que tu as vécu à Cuba, on a beaucoup exigé de toi.
J’avais 12 ans quand je suis retourné à Cuba. Mon père était persécuté au Mexique, alors nous sommes venus en Europe. Durant toute cette période, je n’étais pas le petit-fils du Che. On ne devait pas savoir que nous avions des liens familiaux avec les Guevara. J’étais un enfant comme les autres même si nous vivions dans l’illégalité. À mon retour à Cuba, en rentrant à l’école secondaire, je me suis converti en petit-fils du Che. Sans le savoir, j’ai appartenu à une espèce d’aristocratie révolutionnaire, à une bourgeoisie socialiste qui existait déjà alors, et avec laquelle je n’ai jamais sympathisé. En général les fils des dirigeants ne me plaisaient pas. J’allais à l’école de mon quartier, pas à celle des fils à papa. Mais il y avait une exigence particulière des professeurs à mon égard. Je devais bien me conduire, je devais donner l’exemple, mais j’ai toujours été rebelle, on ne peut rien m’imposer, sinon je fais strictement le contraire. Ma scolarité a été un désastre, je devais être le meilleur et j’ai été le pire des élèves.
J’ai lu dans un de tes témoignages que tu as refusé à Cuba d’entrer dans une Académie militaire.
C’est vrai. Juste avant que se termine ma dernière année dans le secondaire, des types de l’Académie militaire Camilo Cienfuegos m’ont invité à faire partie de ce centre éducatif. À Cuba, nous vivions avec le statut de techniciens étrangers. J’ai dit : « Je suis mexicain et il ne peut y avoir d’étrangers dans les institutions politico-militaires cubaines, alors je ne peux faire partie de cette Académie. » Ils me répondirent qu’il n’y avait aucun problème, que tout était arrangé au plus haut niveau, alors j’ai répondu non merci. De toutes manières, je n’ai jamais adhéré à l’Union des jeunesses communistes, ni à aucune autre organisation officielle.
Il semble que ta vie a été plus liée au monde de la culture qu’à celui de la politique. Tu as appartenu, à Cuba, à un groupe qui vivait en marge de la vie culturelle officielle. Comment tu as vécu cette expérience ?
J’ai fait partie de l’univers culturel punk, marginal des bas quartiers. Je me sentais plus à l’aise dans ce milieu qu’au sein de la nomenklatura. Mais ça ne veut pas dire que la politique ne m’intéressait pas. Hélas à Cuba la politique est le fait de l’État. Dans les dictatures, la politique est l’affaire du gouvernement et elle ne doit pas concerner les gens.
Dans les pays de l’Est européen la nomenklatura s’est emparée, après la chute du mur de Berlin, des leviers économiques. Est-ce un scénario possible pour Cuba ?
La nomenklatura contrôle les entreprises mixtes, mi-capitalistes, mi-« socialistes ». Le pouvoir n’installe pas aux commandes les personnes les plus compétentes pour diriger ces entreprises, mais les inconditionnelles du régime. Par ailleurs, les maffias contrôlent le marché noir depuis des décennies et ceci n’est possible qu’avec la complaisance et la compétence des gens appartenant à l’appareil d’État. C’est de ces milieux-là que sortiront les grands chefs d’entreprises et les grands hommes politiques de demain. Il est clair qu’au sein même du Parti communiste va avoir lieu une guerre de succession pour l’héritage, pour le trône, pour le pouvoir. Raúl Castro (2) ne pourra pas exercer le pouvoir. Il n’a pas la dimension politique et il n’a aucun appui à Cuba. Il est totalement déconsidéré, on ne le craint même pas, c’est tout simplement du mépris. Rien ne lui enlèvera son image d’ivrogne. Et pourtant nous parlons d’une société où le rhum se boit au même rythme que l’eau.
Les gens qui applaudissent aujourd’hui Fidel vont rompre avec tout cela. Quand s’achèvera la contrainte de l’obéissance absolue, la société va changer. Le Cubain est très hâbleur, il n’aime pas rester muet, il doit opiner à propos de tout. S’il ne parle pas de politique, c’est parce qu’on ne lui permet pas. Une de mes grandes inquiétudes est qu’après le processus d’idéologisation forcé se produise un effet inverse à celui qui est souhaité aujourd’hui par le pouvoir, que plus personne ne veuille entendre des choses relatives aux idéologies. Les jeunes ne veulent plus rien savoir du communisme, du socialisme, de l’anarchisme, ni d’un quelconque autre « isme ». C’est un rejet viscéral des idées. Dans la réalité de tous les jours à Cuba, on peut constater que certaines de ces idées sont des mensonges. Ces idées, on ne les a pas fait rentrer par la tête des gens, mais par le cul toute la putain de journée, à l’école, au travail, à la télé et à la radio.
Et c’est là où se situe le principal danger pour la société post-castriste : qu’il y ait un vide idéologique et politique qui soit immédiatement occupé par le capitalisme sauvage. Étant donné les carences matérielles dont souffre le peuple cubain, quand les marchandises américaines rentreront librement dans l’île et que les Cubains pourront accéder à elles, personne ne se préoccupera de politique. Les Cubains vont s’alimenter, réparer leur maison et tenteront de posséder tout ce dont ils ont manqué pendant plus de quarante ans. Il y a un danger d’apathie qui peut entraîner une droitisation. La droite triomphe lorsqu’il n’y a pas de débat politique, quand il n’y a pas de participation citoyenne. Si on ne la pratique pas, la démocratie s’arrête d’exister. La démocratie ne peut pas être freiné, elle se construit pas à pas… Le socialisme aussi, si on ne le développe pas, il meurt. À Cuba, il est mort, il ne reste que ses oripeaux.
Quelles doivent être les principales préoccupations des anarchistes à Cuba ?
À Cuba, il y a des anarchistes, mais il n’y a pas d’anarchisme (3). Les anarchistes ne peuvent éditer un journal, ni avoir une station de radio. Ils ne peuvent même pas dire à voix hautes qu’ils sont anarchistes. La première priorité sera de relever le plus tôt possible les conditions de vie des Cubains. Il faut reconstruire les institutions qui doivent malgré tout continuer à exister et qui sont aujourd’hui en ruine : le système éducatif, la santé, les propres organes du « Pouvoir populaire » (4), cette organisation assembléiste qui sur le papier est une organisation horizontale, mais qui dans la pratique est d’une verticalité totale.
Il me semble que l’un des points fondamentaux est l’appropriation citoyenne de l’anarchisme. Il ne peut être une chose sectaire et de type avant-gardiste. Cela veut dire continuer la lutte pour ne pas permettre aux politiciens professionnels de confisquer l’exercice du pouvoir, sans perdre de vue les objectifs que nous avons à long terme, ces idéaux qui font que nous sommes en marche vers un idéal. Nous devons nous investir dans les luttes que mènent les divers secteurs de la société : les associations de quartier, les associations écologistes… Nous n’aspirons pas au pouvoir, mais nous devons miner le corps social jusqu’à ses fondations. Nous devons participer à toutes les batailles pour l’égalité, la démocratie, le respect. Dans la mesure où il y a des anarchistes qui interviennent dans la société, les idées acrates sont diffusées. Si nous ne laissons pas derrière nous les derniers vestiges du sectarisme libertaire, nous continuerons à être condamnés à la secte, à la minorité… Il s’agit d’insister sur la voie que nous avons choisi durant les dernières décades. Depuis que l’anarchisme a abandonné les méthodes violentes.
Aujourd’hui Cuba est en ruine au niveau économique, mais aussi au niveau éthique. La misère est très importante, il y une grande fracture sociale, avec des différences abysmales, quelquefois plus violentes que dans les sociétés capitalistes, la seule différence est qu’à Cuba, soi-disant, « on est en train de construire une société sans classes ». Pour les anarchistes cubains, dans l’époque post-fidéliste, l’unique chemin sera de participer à la reconstruction de Cuba, à la reconstruction de la société civile, à la reconstruction de l’État. Je le dis sans fétichisme parce qu’il est clair qu’une certaine forme d’État devra se substituer à l’État actuel. Nous les anarchistes, nous devrons participer à la discussion à propos de quel État conviendra à tous. Cela implique l’acceptation momentanée du capitalisme en tant que mode futur du développement. Notre obligation est de le mettre en accusation, en profiter au maximum, le presser, l’« exploiter ». Ceci est fondamental, il faut détruire un système basé sur la répétition, sur l’abrutissement, sur l’ennui…
Quelle est ta position par rapport à la gauche cubaine et latino-américaine en général. Comment te situes-tu dans ce mouvement d’opposition ?
Il y a aussi une gauche citoyenne et civile, qui n’est rattachée à aucun parti. La gauche, par malheur, est chargée de rituels, de hiérarchies et de discours bizarres qui ne sont que des apparences, mais ils corrompent le fond. Une subversion qui reproduit en son sein les formes du pouvoir établi ne sera jamais totalement subversive. Par déformation culturelle, je suis un meilleur dilettante qu’un bon militant. Je ne suis d’aucun parti, je me situe dans la gauche critique de la gauche. Un mouvement d’individus de gauche se développe aujourd’hui. Ils sont capables de s’investir dans les organisations écologistes, étudiantes, culturelles, de quartiers, citoyennes dans le sens le plus large du terme, elles ont une incidence sur les petites choses de la vie locale. Les gens ne veulent plus d’un futur, des lendemains qui chantent, du communisme… Ce qui intéresse les gens c’est les solutions aux problèmes du moment et la gauche doit travailler à ça si elle veut avoir une incidence sur cette abstraction que sont « les gens ». Ce sont les citoyens qui résoudront leurs problèmes. L’unique façon de limiter les pouvoirs de l’État c’est de cesser de faire appel à lui. Nous devons insister, c’est là où sont les germes de l’autogestion, de l’autonomie, de l’auto-gouvernement, même si tout cela est à l’état embryonnaire.
Tu milites au sein du Mouvement libertaire cubain (5) (www.movimientolibertariocubano.org)… Quels projets avez-vous ?
C’est un mouvement qui s’inscrit dans une pratique anti-constitutionnelle, qui ne vise pas la conquête du pouvoir politique, mais à avoir de l’incidence, avec un certain nombre d’idéaux et un certain nombre de solutions qui sont praticables… En ce moment, nous sommes dans la phase de diffusion de nos idées, et également de développement des contacts avec différents secteurs à Cuba et en dehors. L’objectif est de démythifier le régime cubain et de se positionner face à un public politisé. À Cuba, il n’y a pas seulement une dissidence de droite, comme on veut le faire croire. Malheureusement beaucoup de secteurs de la gauche internationale souscrivent à cette idée. Toute cette merde que l’on déverse : « tous les dissidents cubains sont payés par la CIA et le gouvernement des Etats-Unis », tout cela est un mensonge vulgaire. Bien sûr qu’il y a des groupes liés à la droite américaine, mais ce n’est pas le cas de toute l’opposition. La priorité est d’enlever l’appui de la gauche latino-américaine au régime cubain et d’amplifier la discussion.
Je crois que je suis un des membres les plus jeunes du MLC et un des derniers à avoir quitté Cuba, cela fait presque dix ans. Certains compagnons sont partis depuis 1959 ou 1960, et Cuba a définitivement changée pour eux. Ils ont vécu le début du socialisme, moi j’en ai connu la fin… Aujourd’hui à Cuba existe un étrange régime hybride, qui s’alimente des pires choses en ce monde : l’exploitation capitaliste et la dictature propre au socialisme messianique et autocratique cubain, d’une double exploitation en définitive. Comment expliquer à ce peuple que ça n’est pas du socialisme, comment expliquer que le socialisme est quelque chose de meilleur que ça ? Les mots ont été corrompus. Aujourd’hui à Cuba, le socialisme ou le communisme évoquent la dictature et l’anarchie évoque le terrorisme et le chaos, ou dans le meilleur des cas la cause d’adolescents révoltés. C’est pour cela que développer les contacts dans l’île est une priorité et c’est une des choses les plus difficiles. Il y a beaucoup de contrôles et par conséquent beaucoup de peur à Cuba. Quiconque écrit quelques lignes sur la situation cubaine prends vingt ans de prison. Il ne s’agit pas de chercher des martyrs, ni rien de ce genre. À cela, il faut ajouter les restrictions au niveau des communications, et tu fais face une réalité très difficile.
Le capitalisme existe déjà à Cuba et il attend le feu vert pour se lancer à la conquête du pouvoir, de même que la droite et tous les autres courants politiques sont prêts… Aujourd’hui, il faut insister sur le fait que Cuba est un pays comme les autres et que les citoyens cubains ont des besoins similaires à ceux qu’ont les citoyens d’un autre pays. Toute cette histoire que le « Vieux » a inventé en disant que nous sommes une exception, l’avant-garde du monde et que Cuba est un exemple, tout ceci est du chauvinisme à bas prix. Le monde moderne a la particularité de vivre une homologation ou une homogénéisation des sociétés et de leurs nécessités. Ce sentiment d’être une exception ne convient pas à Cuba, ni à aucun pays, car cela mène à l’isolement…
En réalité il s’agit d’une société comme une autre, avec les mêmes différences en son sein, les mêmes contradictions. Surtout aujourd’hui, à l’heure où l’État ne peut plus exercer un contrôle absolu sur les consciences. Le discours officiel est trop en contradiction avec la réalité environnante pour que ce discours se soutienne par lui-même.
Le rôle joué par les contre-cultures est patent dans la société cubaine, qui est aujourd’hui beaucoup plus tolérante qu’il y a vingt ans. Malgré les efforts du gouvernement pour s’opposer aux contre-cultures, la société cubaine se diversifie en laissant derrière elle les défauts de la pensée unique, de la morale absolue. Et cette transformation a lieu en provenance des couches les plus basses de la société. En plus, il y a le phénomène du croisement entre les traditions, les coutumes cubaines et les modes provenant de l’extérieur… Moi, j’ai eu à subir la dernière salve des prohibitions culturelles cubaines. Nous n’étions pas seulement réprimés par l’État, mais aussi par la société elle-même. Faire partie d’une des tribus urbaines était très mal vu. À l’école, dans le quartier, au travail ou dans un quelconque lieu où tu pouvais te faire remarquer. Le rock, particulièrement, était vu comme la musique de l’ennemi, la musique de l’impérialisme. On appelait ça de la déviation idéologique. On nous appelait les anti-sociaux, et bien sûr, pour ne pas être en reste, nous revendiquions cette appellation.
Il gagna la sympathie de toute la jeunesse avec une chanson sur le fils de Guillaume Tell où il criait : « et maintenant c’est au tour du père d’avoir la pomme sur la tête ! (6) ». Ses concerts étaient impressionnants pour ce qu’ils signifiaient pour une jeunesse qui se sentait constamment persécutée et toujours exclue.
Ce n’est pas à Cuba qu’est en train de se jouer le futur de l’humanité, ni de l’impérialisme, ni d’aucune chose de ce style. C’est le futur des Cubains qui se joue et rien de plus. Et si la gauche internationale est en vérité solidaire du peuple de Cuba, elle doit alors répudier la dictature. Cela n’implique pas l’idée de renoncer aux idées anti-impérialistes et anti-capitalistes.
L’idée selon laquelle la culture doit être un objet de culte est une énormité. L’État cubain, dans le débat sur l’objectif et le subjectif, a fini par convertir la culture, l’histoire, la patrie, le socialisme, le peuple, la révolution en objet. Il a fini par dévaloriser le subjectif qui est le sujet, l’individu. Le socialisme n’est pas un édifice qui doit se construire. Il doit s’apparenter à un organisme vivant, composé de millions de cellules (les individus) qui se développent. Ce sont des choses qui se forgent à partir d’en bas, qui ont avoir avec la rupture de l’unité matérielle et avec l’acceptation de cette diversité cellulaire qui forme la réalité. Cette acceptation sociale de la différence est très importante. Si le « Vieux » était mort dans les années soixante, sans un tel niveau d’acceptation de la diversité, peut-être que le régime survécu à la mort de son Commandant en chef, mais aujourd’hui non. Le fidélisme va mourir parce que la société ne va plus accepter un modèle unique, et parce qu’il n’y a personne dans la sphère castriste qui ait la capacité de cohésion qu’à Fidel Castro.
Propos recueillis, en exclusivité pour Le Monde libertaire, par Daniel Pinós. Novembre 2005
_________________________
Notes :
[1] Le « foquismo » était une stratégie de guerre basée sur le développement de foyers révolutionnaires dans plusieurs parties d’un territoire. Che Guevara mit au point cette stratégie que développaient les groupes de guérilla agissant dans différents pays durant les décades de 1960 et de 1970.
L’« homme nouveau » n’est nullement égalitaire chez Guevara. Selon lui il existe trois strates : en premier lieu Fidel, avec un culte de la personnalité clairement affirmée, en second « les meilleurs entre les bons », c’est-à-dire l’avant-garde organisée et, finalement, le « peuple dans son ensemble ». Ces strates définissent le type de société à construire. Outre la vision quelque peu militarisée des masses populaires, « l’immense colonne », ce qui retient l’attention, c’est la notion de sacrifice.
[2] Raúl Castro a été désigné par son frère aîné Fidel pour lui succéder, après sa mort, en tant que Commandant en chef.
[3] Dès 1960, dès le début de la révolution cubaine, les anarchistes, qui s’opposaient aux premières mesures autoritaires de Fidel Castro, furent victimes de la répression. Leurs organisations furent dissoutes, les militants furent persécutés, exécutés, emprisonnés ou contraints à l’exil.
[4] L’État, outre la télévision et les radios qui servent de relais, s’appuie sur l’armée, la police et sur les Comités de défense de la révolution (CDR), organes du « Pouvoir populaire » qui quadrillent le pays, pâtés de maisons par pâtés de maisons. Les représentants du « Pouvoir populaire » sont élus à partir d’une liste unique et sont totalement inféodés au Parti communiste.
[51] Le Mouvement libertaire cubain tente de stimuler la naissance, malgré les risques de répression, d’un activisme révolutionnaire à Cuba, de façon à construire un mouvement qui participe aux luttes des opprimés. C’est un réseau qui coordonne des individus et des collectifs à Cuba et dans le monde entier.
[6] Le rôle du père étant tenu à Cuba par Fidel Castro, mais sans le nommer bien entendu !

