Cinéma : La vie c’est filmer
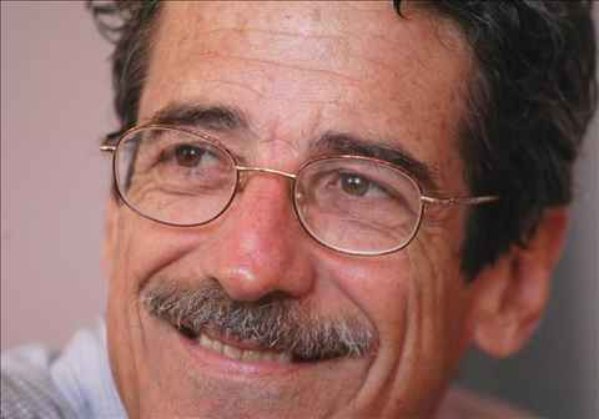 C’est toujours un fait extraordinaire que la vie culturelle d’un pays s’émeuve pour une œuvre d’art. Généralement, se sont des scandales de diverses natures qui obtiennent un tel effet – la majorité à caractère extra artistique –. Cependant, depuis sa timide Première jusqu’à sa permanence durant tout un mois, à salle comble, dans la Cinémathèque de Cuba, le film Suite Habana, de Fernando Pérez, a provoqué une émotive réception de la part des plus diverses couches de spectateurs, et parvint même à accumuler un nombre significatif de commentaires – la majorité laudatifs – dans une presse culturelle aussi restreinte que sa collègue cubaine quand il s’agit de saluer des œuvres d’art ayant des intentions critiques marquées de l’environnement quotidien national.
C’est toujours un fait extraordinaire que la vie culturelle d’un pays s’émeuve pour une œuvre d’art. Généralement, se sont des scandales de diverses natures qui obtiennent un tel effet – la majorité à caractère extra artistique –. Cependant, depuis sa timide Première jusqu’à sa permanence durant tout un mois, à salle comble, dans la Cinémathèque de Cuba, le film Suite Habana, de Fernando Pérez, a provoqué une émotive réception de la part des plus diverses couches de spectateurs, et parvint même à accumuler un nombre significatif de commentaires – la majorité laudatifs – dans une presse culturelle aussi restreinte que sa collègue cubaine quand il s’agit de saluer des œuvres d’art ayant des intentions critiques marquées de l’environnement quotidien national.
Mais dès ses débuts comme metteur en scène, vers la décennie des années 80 – avec le film Clandestinos –, et au long de toute sa production postérieure - Hello, Hemingway ; l’impactant Madagascar ; La vida es silbar – Fernando Pérez a tracé une route artistique qui a rendu presque prévisible un aboutissement si esthétiquement obtenu et humainement profond comme celui de ce film extraordinaire qu’est sans aucun doute Suite Habana.
Mais, qui est Fernando Pérez ? Comment est-il arrivé au cinéma ? Quels sont ses obsessions et ses rêves ? Pour le savoir, le mieux est de l’écouter, dans les réponses qu’il nous a données il y a quelques mois
.
Un homme et un destin
En réalité, être metteur en scène cinématographique, à Cuba, est encore une aspiration un peu étrange. Dans ton cas, comment est apparue cette vocation ?
Je crois que toute la faute vient de mon père. Il était facteur, à Guanabacoa, un village proche de La Havane, où je suis né. Mais c’était un grand passionné de cinéma et en 1958, j’avais 14 ans, nous allions très fréquemment dans les salles, presque trois fois par semaine. En réalité, il aimait toutes les manifestations artistiques, bien que son niveau culturel ne soit pas très élevé, car il n’a jamais pu terminer ses études et très tôt il a dû gagner sa vie pour soutenir sa famille comme facteur.
Je n’oublierai jamais le jour où nous sommes allés voir Le pont de la Rivière Kwaï, de David Lean. Ce film nous a beaucoup impressionné et à la sortie du cinéma il m’a dit : « Ce film est très bien dirigé ». Et je lui ai demandé ce que faisait un metteur en scène pour bien diriger. Bien qu’il n’ait pas su me l’expliquer, j’ai senti à ce moment, et je lui ai dit, que j’aimerais être metteur en scène. Je me souviens de cette expérience comme d’un moment très décisif de ma vie. Il est évident que faire du cinéma, en 58, à Cuba, était un rêve impossible, comme le sont généralement presque tous les rêves.
Et comment le rêve a-t-il commencé à devenir une réalité ?
En réalité mes parents ne m’ont jamais obligé à étudier une carrière spécifique, mais il y avait des nécessités péremptoires pour que j’étudie le commerce, car ainsi j’aurais un travail immédiat assuré et la possibilité d’aider à la maison. Mais la vérité est que cela ne m’intéressait pas. Un beau jour je me suis dit : « Je dois essayer d’entrer à l’ICAIC ». Et durant l’année 1962 j’ai décidé de m’y présenter. Ils m’ont fait remplir une fiche, qui était un questionnaire d’une quinzaine de pages, où tu devais démontrer tes connaissances non seulement quant au cinéma mais aussi en littérature, en arts plastiques, et finalement sur ta formation professionnelle. Six mois ont passés et ils m’ont finalement appelé pour que je commence à travailler comme assistant de production C.
J’étais réellement très timide à cette époque et ils m’ont mis à travailler sur une coproduction, avec un metteur en scène tchèque qui faisait un film appelé ¿Para quién baila La Habana? Et là j’ai dit : « Bon, je vais voir comment je fais face au monde du cinéma, je vais voir comment on fait du cinéma ». Mais en réalité le travail d’assistant de production C était pratiquement celui de coursier et si je te dis que j’ai vu le tournage d’une séquence cela a été beaucoup…
Mais tu es resté à l’ICAIC… ?
Oui, et comme il existait la possibilité de la création d’une école de cinéma ici à Cuba, ils m’ont dit que je devais élever mon niveau culturel. Je savais que je devais passer au moins par l’université et, en 1963, j’ai pu y entrer pour étudier la littérature hispanique et l’histoire de l’art, car l’école de cinéma n’était pas encore fondée. Quand j’ai eu terminé la carrière en 70, ils m’ont appelée pour que je commence à travailler comme assistant de direction dans le film Una pelea cubana contra los demonios de Tomás Gutiérrez Alea. Et là je peux dire que j’ai commencé ma véritable formation cinématographique, à connaître le cinéma depuis l’intérieur, à faire un travail proche du metteur en scène.
Ensuite j’ai fait d’autres assistances, jusqu’à ce qu’ils m’offrent l’occasion de faire mon premier documentaire, en 1974. C’était une idée qui est apparue en collaboration avec l’écrivain Jesús Díaz, qui à ce moment faisait aussi ses premiers pas comme metteur en scène. Le projet tournait autour du nationalisme portoricain et devait durer quinze minutes, mais à la fin nous avons eu un film d’une heure vingt, intitulé Puerto Rico, et qui, vu de maintenant, était une expression de l’époque : c’est un cinéma militant, engagé avec la cause de Porto Rico et de l’Amérique Latine.
Que dois-tu à cette période de documentaliste comme metteur en scène ?
En 1979 j’ai fait partie de l’équipe de réalisation du Noticiero ICAIC Latinoamericano, sous la direction de Santiago Álvarez… Jusqu’à ce moment je croyais avoir acquis des notions générales, j’étais familiarisé aux possibilités du langage cinématographique, mais c’est réellement dans le Noticiero, sous la direction de Santiago et avec la possibilité de tourner la réalité quotidienne, obligé de trouver des solutions pour manier l’image et l’information, que j’ai réellement eu mon école fondamentale. À partir de ce moment j’ai fait un certain nombre de documentaires de plus, mais déjà avec l’idée de faire le saut au cinéma de fiction, qui est ma véritable vocation. Mais l’important est que j’avais pu faire quelques documentaires qui, de mon point de vue, ont été fondamentaux pour moi, car j’y travaillais déjà les mises en scène, comme dans la fiction.
Comment es-tu passé du documentaire à la fiction ?
Cela a été très difficile. Même si les productions cinématographiques cubaines n’affrontaient pas les problèmes économiques d’aujourd’hui, durant les années 70 et au début des années 80, il n’y avait pas de possibilités pour tout le monde. Je crois que la naissance d’une nouvelle génération de cinéastes ut beaucoup retardé, non seulement quant aux metteurs en scène, mais aussi pour les éditeurs, les photographes… Bien que nous fassions des propositions, il y avait le préjugé que nous n’étions pas assez mûrs pour pouvoir faire ces choses, et ce n’est que vers le milieu des années 80 que l’ICAIC s’est rendu compte que les jeunes cinéastes devant faire leur apparition commençaient à devenir vieux. Une convocation parmi les documentalistes a été ouverte et, finalement, un groupe de dix metteurs en scène est resté, et nous avons réalisé notre première œuvre durant la seconde moitié des années 80.
À partir de ce long lien avec le cinéma, serait-il possible de souligner le rôle du cinéaste à Cuba ?
Regarde, comme tout groupe humain et créatif, nous ne sommes pas homogènes. Les cinéastes cubains ont été soumis à diverses formations, ils ont diverses origines, desseins et expériences. Mais je crois qu’il y a des lignes générales et un cinéaste à Cuba ne doit jamais être vu comme un être privilégié, d’un autre monde. Je crois que ce qui nous définit est d’essayer de faire un art qui ait une répercussion sociale, capable de contribuer à définir les inquiétudes qui non seulement font partie de nous-même comme individus, mais aussi de notre collectivité. C’est pour cette raison, avec les plus divers styles, que nous faisons un cinéma qui prétend influencer la réalité. Nous ne faisons pas un cinéma éducatif, ni programmatique, ni pour gagner de l’argent. Notre cinéma nous apporte les plus grandes satisfactions quand nous voyons qu’il a une répercussion chez les spectateurs cubains et sur la façon d’aborder la réalité cubaine.
Quand tu vas à l’étranger et que tu vois un collègue qui gagne beaucoup d’argent et qui a une très grande reconnaissance sociale, fais-tu une comparaison avec la situation des cinéastes d’ici ?
Il est certain qu’il y a de très grandes différences, qui concernent non seulement les cinéastes, mais n’importe quel professionnel à Cuba – les médecins, les scientifiques, les sportifs –. Hors de Cuba ils pourraient être millionnaire et avoir un standard de vie réellement supérieure. Mais pour ceux qui sont restés ici, et pour moi en particulier, je crois que c’est seulement à Cuba que je peux faire le cinéma que je veux. Ici j’ai eu la liberté de faire un cinéma que, s’il échoue économiquement, ça ne m’affecte pas. D’autre part, si je fais un film qui a du succès, cela ne me rapporte pas d’autres avantages que la satisfaction de savoir que je l’ai bien fait. Et d’une certaine manière cela me permet comme artiste, d’être plus lié à une réalité qui est partagée par tous.
Evidemment, je ne voudrais pas que ceci soit interprété comme une image paradisiaque du cinéma cubain, ni que l’on pense que c’est une option parfaite, parce que nous avons aussi beaucoup de problèmes à affronter… Par exemple, je crois que j’ai commencé à une époque de grandes possibilités et que ma génération a obtenu une maturité à la fin des années 80, qui promettait un boom du cinéma cubain dans les années 90. Mais cette possibilité a été frustrée et de nos jours c’est beaucoup plus dramatique pour les jeunes qui veulent faire du cinéma, car le processus sélectif est beaucoup plus fermé maintenant.
Comment t’a affecté le phénomène de la censure et l’autocensure ?
Il n’y a pas d’appareil de censure à l’ICAIC. Il se peut que quelqu’un présente un scénario ayant une thématique épineuse et entre collègues, et ensuite avec la direction de l’institut, on discute certains aspects et comment les manier artistiquement. Mais il n’y a pas de directives qui te disent que l’on ne peut pas faire cela ainsi, ceci est totalement interdit, etc.… Comme cinéaste j’ai toujours fait les films que j’ai voulus. Il est vrai qu’il y a eu des discussions, mais à la fin j’ai fait le film que j’ai voulu faire.
Et tes collègues aussi ?
Je crois qu’à Cuba nous faisons face à des problèmes avec le maniement de l’information. Par exemple, les moyens de communication massive sont soumis à un contrôle beaucoup plus dirigé que le cinéma, le théâtre, la littérature. Suite à une politique que l’ICAIC a su maintenir durant de nombreuses années, le cinéma se déplace dans une complexité beaucoup plus grande. Cela ne veut pas dire que tout soit idéal. Les problèmes, que nous avons fortement affrontés, ont plutôt à voir avec la projection du film. L’ICAIC fait face aux restrictions pour certaines présentations, elle doit s’expliquer avec les hautes sphères du pays en rapport avec la culture où avec d’autres d’une mentalité beaucoup plus conservatrices qui ne considèrent pas les sujets appropriés par exemple, et là commencent les discussions. Dans certains cas, à l’extrême, on est arrivé à postposer la Première d’un film et dans d’autres, à nous résigner qu’il ne pourra pas être exhibé.
T’es-tu autocensuré ?
Je me suis toujours proposé de faire ce que j’ai voulu à chaque moment. Même, quand ils m’ont demandé que je fasse un film critique, ce que j’avais à l’esprit était de faire un film sur les années 50, et j’ai tourné Hello, Hemingway. Quand j’ai senti que je devais faire un film assez compliqué sur mon environnement, la réponse a été Madagascar. En réalité je n’ai jamais pensé si c’étaient des histoires adéquates ou s’ils allaient provoquer certaines réactions, car si je pense ainsi, je déforme un processus de création où la sincérité et les idées auxquelles on croit deviennent des idées étrangères.
Je crois que c’est la responsabilité qu’on doit se proposer, ou au moins, c’est celle que j’ai comme artiste à Cuba. Donc, si je vais dire quelque chose qui m’inquiète ou qui me préoccupe, comme artiste et citoyen de ce pays, j’essaye de les dire à ma façon. Je me suis toujours valu d’une phrase d’un réalisateur étasunien, Nicholas Ray, quand il a dit qu’il n’y a pas de formule pour le succès, mais qu’il en existe une pour l’échec, qui est celle d’essayer de contenter tout le monde. Un art qui contente tout le monde court le risque d’être un art raté.
.
IPS Cultura y Sociedad


