Une « Casa Cuba » sans chambres pour les domestiques
Essai de revendication du possible : viabilité et nécessité de l’action solidaire à Cuba à partir de l’analyse de l’ethos populaire face aux scénarios des réformes
Cuba : la transgressive versatilité d’une métaphore
La métaphore Casa Cuba est une métaphore cordiale, certes, mais elle est aussi des plus extraordinairement versatile. Il nous paraît intéressant d’explorer cette versatilité, juste à partir de ce point où convergent un processus de révolution et un processus de réconciliation.
Non seulement notre métaphore renvoie à la spiritualité, mais aussi à l’architecture (beauté, proportions, etc.), l’ingénierie (comment reconstruire une maison si nous ne savons pas quels sont les murs porteurs ?) et la géométrie (la topologie des espaces ouverts et fermés, du dehors et du dedans; l’ouverture et la fermeture comme noyaux de l’idée même de l’ordre géométrique ou du chaos). Elle renvoie surtout à la politique : Aristote opposait déjà le gouvernement d’une maison à celui d’une cité ; les Romains introduisirent le terme dominium, dont dérive « domination », à partir d’une racine aryenne qui signifie précisément « maison » (comme en russe : dom). Et c’est là que réside le potentiel transgressif de la métaphore Casa Cuba : étant donné l’intention de son auteur et de ses autres promoteurs, il ne s’agit pas de reproduire dans notre république une « maison » qui – comme à un certain moment de l’Empire romain – soit un paradigme de domination, mais tout le contraire. Nous utilisons cette métaphore comme exemple inspirateur de ce que pourrait être dans la société cubaine le pouvoir de la cordialité horizontale : de relations exemptes de domination. Autrement dit, dans un sens opposé à celui d’Aristote et des empereurs de Rome, qui vivaient dans des sociétés où les maisons centrées sur le pater familias étaient les noyaux d’un système asymétrique : patriarcal et esclavagiste. Soit dit au passage, identique aux maisons seigneuriales du Cuba colonial…
Nous, au contraire, nous cherchons dans la métaphore de la maison ou du foyer familial un potentiel pour l’émancipation et la réconciliation entre les Cubains et les Cubaines. Pour « l’exercice intégral de soi et le respect à l’exercice intégral des autres ».
Ce qu’on ne publiait pas dans Sputnik
Dans les lointaines années 80, pleines d’espérances pour tant d’entre nous, la populaire revue soviétique Sputnik nous apportait d’impressionnantes nouvelles des grandes transformations qui s’opéraient dans le pays qui fut le premier à s’auto-définir comme « socialiste ». Tout cela était (et est encore) très controversé, jusqu’à un tel point que la revue cessa d’être vendue à Cuba, mais je soupçonne (et je pourrais presque l’assurer) que même Sputnik ne reproduisit jamais dans ses pages le moindre reportage sur le mouvement Liouber, un sujet qui, dans la seconde moitié de cette décennie, fut un hit de la presse qu’on lisait à l’intérieur de l’URSS.
Moscou est entourée de villes ouvrières, où se trouvent quelques-uns des grands centres manufacturiers russes, à l’image de ce qui existe dans les périphéries urbaines et les banlieues d’autres pays industrialisés. Les capitales (surtout leur quartiers centraux) deviennent les sièges des grandes administrations, de toute sorte d’institutions techniques et de structures politiques, regroupant de la sorte les grands décideurs du système. Les centres méga-urbains – et la capitale soviétique n’était pas une exception – sont plus ouverts aux flux culturels internationaux et aux identités multiples.
Vers le milieu des années 80, les villes soviétiques fourmillaient de toutes sortes de « mouvements informels de jeunes » : fans de football, hippies, punks, amateurs de heavy metal ou de break dance, dont l’aspect même indiquait leur militantisme culturel. Et c’est alors que surgirent les lioubera.
Baptisés ainsi en référence à Lioubertsy, une ville située à quelques kilomètres de Moscou, là où naquit le mouvement, les lioubera étaient essentiellement des jeunes gens qui faisaient des exercices physiques durant les années antérieures au service militaire (lequel, en URSS, n’était pas seulement obligatoire – deux ans – mais aussi très dur). Ils se concevaient eux-mêmes comme les partisans d’un mode de vie sain, comme des fils d’ouvriers, par opposition aux secteurs « malades » ou élitistes de la société, des catégories qui incluaient les autres mouvements informels considérés comme « agressifs ». Et c’est pourquoi l’entraînement de tout liouber n’incluait pas seulement la culture physique mais aussi les techniques de combat : l’objectif moral était rien de moins que de « nettoyer » la capitale soviétique des éléments indésirables (asociaux, sous-cultures « agressives », groupes néonazis naissants, fanatiques de sports, mais aussi les homosexuels, les rockers, etc.). Le militantisme des lioubera était fondé sur les valeurs de masculinité, d’amitié et de patriotisme, mais sa réalité fut très sujette à caution : on parle de bagarres impliquant des milliers de jeunes gens de chaque camp pour le contrôle des principaux parcs de Moscou, des rixes où le camp des lioubera représentait celui des « bons garçons » à cause de leur ascendance ouvrière, mais en même temps ils étaient vus comme des intrus puisqu’ils ne vivaient pas dans la capitale même et ne semblaient pas comprendre ce que signifie le respect de la diversité. Ce respect était en train de devenir un principe de plus en plus populaire – surtout parmi les élites intellectuelles et les catégories sociales politiquement contestataires – alors que, dans le pays, les libertés démocratiques et les règles de cohabitation correspondantes semblaient s’imposer. Au beau milieu des débats de l’époque de la perestroïka, le thème du conflit des lioubera avec d’autres jeunes devint aussi un thème populaire, jusqu’à ce que, en 1990, le mouvement disparaisse curieusement… Ce n’est pas que les jeunes des banlieues aient cessé de s’adonner à leurs exercices et leurs entraînements, pas le moins du monde. Ce qui se passe, c’est qu’il y eut un changement politique et un autre changement, encore plus profond, économique celui-là. Le réseau liouber en subit les conséquences. Pendant deux ans environ, quelques jeunes gens dépassés par les événements continuèrent de déambuler dans les rues de Moscou en portant de petits badges avec le visage de Lénine mais la majorité d’entre eux se mirent à la disposition du crime organisé de Lioubertsy, dont ils devinrent les exécutants. Une partie d’entre eux périt dans les combats entre mafias qui marquèrent la Russie des « dures » années 90. D’autres parvinrent à se réinsérer dans la société et sont aujourd’hui des gens de métier, des professionnels, des ouvriers. Ce lien avec les éléments criminels et surtout l’incapacité à formuler des perspectives alternatives de quartier indépendantes de la politique de l’État, disqualifia un mouvement déjà très controversé.
J’ai été très frappé par le fait qu’un des rockers russes les plus connus, qui vivait dans cette même ville de Lioubertsy et qui aurait dû être logiquement une cible des « nettoyages » des lioubera, raconte aujourd’hui, plus de 20 ans après, qu’il ne fut jamais agressé parce qu’il était du « même quartier » qu’eux. Il est évident que la cordialité du « terroir », le fait d’avoir en commun les mêmes souvenirs d’enfance, d’avoir des parents qui avaient travaillé dans les mêmes usines, l’emportait sur les affiliations diverses aux sous-cultures juvéniles.
« Cerro Cerra’o » versus « Habana Abierta »
Mais quel est le rapport de tout cela avec Cuba ? Je répondrai à cette question par une autre question : pourquoi dans les terriblement difficiles années 90 naquirent des projets musicaux aussi fascinants que « Habana Abierta » (et ce fut aussi l’époque de l’émergence du rap cubain et de son festival coordonné par GrupoUno, du festival Rotilla, aujourd’hui fameux, ou du pic de popularité connu par des trovadores « durs » comme Carlos Varela et Santiago Feliú), alors que la première décennie du XXIe siècle voit la domination presque totale du reggaetón ? Quels désirs, quelles pulsions exprime la consigne de « Cerro Cerra’o » (1), si contraire à l’idée d’une « Habana Abierta [Havane ouverte] » ? Est-ce qu’il n’y eut pas de pénuries dans les années 90 ? Est-ce que personne ne se souvient plus de l’eau sucrée, du hachis de peau de banane, des coupures d’électricité, du boom du « jineterismo » (2), du choc des nouvelles relations mercantiles venant se heurter à la solidarité traditionnelle, cordiale et révolutionnaire, des habitants de cette île ? Est-ce que la situation économique ne s’est pas améliorée ? Et qu’en est-il de la situation morale ? Ou est-ce qu’une nouvelle génération serait en train de fixer de nouvelles règles ? En définitive, est-ce que quelqu’un comprend ce que signifie pour un jeune qu’un quartier soit « fermé » ?
Il suffit peut-être d’écouter les paroles du reggaetón d’Insurrekto (je fais allusion à « Cerro Cerra’o »), pour être en mesure de répondre à cette dernière question. Il semble que, peu à peu, l’imaginaire de notre jeunesse des banlieues se met à ressembler à celui des lioubera russes dont nous parlions plus haut. La différence est qu’ici l’attitude qui domine consiste à « fermer » son quartier et qu’il ne s’agit pas en l’occurrence de « nettoyer » la mégalopole de tous les « éléments indésirables ». Cela dit… Est-ce qu’on a oublié les cris proférés à La Havane, dans notre Havane, quand Industriales remporta le championnat de Cuba de base-ball ? Est-ce que quelqu’un se souvient encore du mot palestino [palestinien] (3) ? Est-ce qu’on se souvient de ces foules qui parcouraient les quartiers de La Havane en proférant des insultes contre les « Orientaux » ?
Je n’ai pas d’expériences vécues récentes d’autres régions du pays, mais ce qui se passe dans les quartiers de la capitale dénote une progressive mais persistante érosion de la si fameuse « solidarité » qui – dit-on – caractérise les Cubains. Une Havane de la cordialité, où les gens ne veulent qu’un « cachito pa’vivir » [un petit quelque chose pour vivre], où on refuse absolument la régulation par la voie de l’autoritarisme mais sans parier sur la stratégie du « sauve qui peut » , s’est dissipée peu à peu, au moins dans une partie significative de quartiers et de secteurs sociaux. Il suffit de prendre un omnibus ou d’observer comment on traite les étrangers. Il y a même un certain nombre d’acquis relativement récents (années 70-80) en matière de respect entre les genres qui se sont perdus peu à peu : je pense, par exemple, au traitement familier et habituel de « mami », couramment donné aux femmes dans les rues, aujourd’hui symétriquement complété par celui de « papi » entre les jeunes eux-mêmes.
Des décennies de mauvais « marxisme soviétique » – baptisé par plus d’un de mes amis « marxisme de la langue de bois » – ont suscité l’essor d’une sorte de sens commun qui prétend expliquer les changements de l’ethos à partir des carences économiques. Je me souviens de ce jour où, après avoir assumé la responsabilité d’une étude promue par le Bureau politique sur les causes et les conditions de la corruption à Cuba, les membres (moi y compris) de notre équipe de recherche nous nous proposâmes d’expliquer l’érosion de la légalité à partir de la détérioration de la situation économique au cours des années 90… À ce moment-là, notre directrice nous opposa un argument critique qui fut une surprise pour tous les présents : autour des années 50, dans les quartiers les plus pauvres et les plus périphériques de La Havane, il était d’usage de mettre à sécher des vêtements dans des espaces facilement accessibles de la rue. Dans un environnement marqué par la pénurie, l’honnêteté était une valeur habituelle, les maisons n’avaient pas de grilles, les vols étaient chose exceptionnelle et ils étaient condamnés par tous. Ce simple exemple montre que les conditions économiques ne produisent pas mécaniquement certaines valeurs.
Plus récemment, et toujours dans le même sens, un autre notable collègue attirait l’attention sur le fait anthropologique de la disparition du fiado (4). Autrefois, il était normal que les vendeurs de biens et services au public (les épiciers, les barmen, et même les médecins qui avaient un cabinet privé) fassent crédit à leurs clients habituels. Quand le cuentapropismo [la petite entreprise individuelle] refit surface dans les années 90, toute trace du fiado disparut pour ne plus revenir (jusqu’à présent du moins).
De plus, une attitude d’appropriation rapace, et son complément, le mépris de ce qui n’est pas « à moi » met en évidence l’érosion des frontières entre privé et public. Qui ne se souvient de cette consigne en faveur de la consommation de produits nationaux : « Lo mío primero » [Ce qui est à moi d’abord], si courante dans les années 90 ?
Alors, est-ce que les valeurs sont des choses qu’on peut enseigner ? La réponse paraît évidente, mais cela ne fait guère avancer. Tout semble indiquer que nous sommes en présence d’une profonde crise systémique, et qu’il n’est pas possible de résoudre le problème en attaquant les symptômes. Beaucoup de ceux qui débattent – trop d’entre eux, même – semblent ignorer que l’éthique opère comme une partie d’un système de relations, de pratiques et d’expériences sociales qui a changé peu à peu ; les projets de vie des gens ont changé, il y a des propositions au niveau macro-social, mais dans quelle mesure sont-elles fidèles à la façon de vivre quotidienne à Cuba ? Est-ce que l’incertitude de la vie au jour le jour pourrait se résoudre avec plus d’incertitude face au changement ? Comment réduire la complexité des décisions quotidiennes ? Est-ce que nous n’allons pas engendrer encore plus de crise que celle que nous avons déjà si nous ne tenons pas compte des « agendas politiques personnels » (5) de chaque habitant de l’île, avec toutes leurs échéances possibles ?
Il y aura toujours quelqu’un pour attribuer cette incertitude existentielle, éthique, esthétique et quotidiennement politique à la culture du reggaetón et à la « perte des valeurs »… Mais c’est que le reggaetón n’est ni un simple genre musical ni un agent de changement (un ami me disait que le reggaetón est le produit de l’école cubaine : d’où, si ce n’est de l’école, sont issus ses principaux promoteurs ?). Le reggaetón dans le Cuba d’aujourd’hui est une idéologie, qui a un appareil de promotion (les méga-entreprises de spectacles) et qui consolide ce qui a déjà été conquis pour les pratiques (qui s’expriment dans des conduites et des valeurs) en tant qu’idéologie légitime. Il suffit de se rappeler que la presque seule et unique fois où le reggaetón fut utilisé pour « transmettre » des valeurs « positives » (le vidéoclip Creo, du chanteur Baby Lores, visant à promouvoir la fidélité à la figure historique du Commandant en chef) est apparue avec une pièce qui, au-delà du culte de la personnalité du leader, établit une règle de comportement fondée sur l’usage de la force brute, sur le mépris des idées différentes, de la pensée en général (« la verdad no se ensaya »)… Malgré les éloges, dont celui du compétent critique Rufo Caballero, aujourd’hui disparu, la pièce de Lores constitue une démonstration d’inconsistance aux yeux de ceux qui, à l’instar de Rufo, sont étrangers à la culture du reggaetón et au cercle des amis intimes de Lores : la jaquette du CD qui contient cette chanson est entourée de la quadruple consigne « La machine à faire de l’argent ». Mais c’est que pour Lores et ses fans, il n’y a pas de contradiction entre ce slogan et le fait que le chanteur de Creo apparaisse sur la même jaquette avec un béret portant l’image du Che : le sens même du mot « vérité » a été supprimé (6), tout est permis, grâce à un concept d’inclusivité qui ne contrevient pas à l’intime structure des sociabilités qu’exprime et encourage le reggaetón.
Et cette structure de sociabilités fondée sur l’individualisme, la consommation ayant pour seul but une jouissance matérialiste effrénée, la transformation de la femme en éphémère objet sexuel, l’apologie du pouvoir de l’argent, l’hyper-compétence, la suppression des solidarités au-delà de la convenance réciproque et la suppression de toute création esthétique, de tout travail, de tout exercice intellectuel ou simplement de toute pensée qui irait au-delà de l’intérêt mis à resolver (7) pour passer ensuite au moment de la jouissance. Une structure qui est aussi une spiritualité, et disons-le maintenant sans ambages : le reggaetón est une culture qui exprime et qui est animée par une spiritualité crûment capitaliste. Et on pourrait ajouter, une spiritualité globalisée (est-ce que cette thèse requiert une démonstration ?).
Pour revenir au thème, très représentatif et excellent musicalement, « Cerro Cerra’o », où Insurrekto élabore une esthétique qui conduit simultanément à l’apologie et à la critique du statu quo reconstruit, d’une certaine façon, par le concept de quartier humble habanero, nous retiendrons la force de la notion même de cierre [fermeture]. C’est là l’idée qu’il pourrait exister dans la ville des territoires « No go » (une expression qui, en anglais, signifie tolérance zéro pour les « intrus » venus d’autres territoires). Nous pouvons observer la propagation de cette façon d’assumer la territorialité identitaire dans les graffitis que des groupes de jeunes laissent dans les guaguas [bus ou mini-bus] ou sur les murs de la ville. Les noms de ces jeunes gens sont liés fréquemment au quartier – « Yordan de Jesús María » –, et souvent apparaît aussi le mot « Cerrao ».
Au-delà de la souhaitable ouverture chantée par ce projet terriblement divers et nomade que fut Habana Abierta, ce qu’on perçoit le mieux dans l’esthétique musicale et celle de la rue d’aujourd’hui est l’apologie de quelque chose de très ressemblant aux bandes juvéniles. Souvenons-nous des lioubera russes et demandons-nous si notre société pourrait affronter l’apparition de phénomènes de ce genre dans nos grandes villes ? Parce que, souvent, je pense que l’idée idéologique et esthétique en est déjà présente… Ce qui manque encore, c’est que de véritables bandes finissent par se constituer pour de bon, surtout maintenant que les lycéens viennent tous « de la rue »… Je vois les spectres des terribles maras (8) d’Amérique centrale (qui exportent même leurs pratiques aux États-Unis) ou des gangs associés à des écoles urbaines de Londres (celles-là mêmes qui ont provoqué les récentes émeutes) ou les démonstrations des supporters de clubs de football en Europe ou même en Russie, qui sont le ferment nutritif des expressions juvéniles les plus autoritaires, violentes et xénophobes : quelqu’un se souvient du mot palestino (9) ? On pourra penser que j’exagère mais nous vivons dans une société qui change à toute allure et c’est le tissu social lui-même qui est devenu problématique.
L’énigme du « monde de vie populaire »
Un prêtre salésien espagnol, psychologue de profession qui vit et officie dans un quartier de Caracas – le professeur Alejandro Moreno – a élaboré la terriblement intéressante notion analytique de « monde de vie populaire ». Selon le père Moreno, la convivialité quotidienne qui caractérise les quartiers pauvres d’Amérique latine n’est pas réductible dans ses logiques aux notions rationalisées et individualistes qui animèrent le devenir de la modernité dans ce qui est aujourd’hui le Premier Monde. En tant que chercheur qui cohabite avec la communauté qu’il étudie, Alejandro Moreno a proposé une approche relationnelle qui recourt, entre autres, à la scolastique catholique et romaine médiévale (Thomas d’Aquin) et aux enseignements de philosophes religieux juifs comme Martin Buber. Ce lien n’est cependant pas le fait du hasard : le père Moreno lui-même note l’incidence épistémologique de l’organisation communale du Moyen-Âge européen et des modes d’organisation du judaïsme populaire ashkénaze (respectivement) dans ces approches théoriques. Autrement dit, il y a, selon Moreno, un « air de famille » entre la manière dont on cohabite aujourd’hui dans les quartiers pauvres de « Notre Amérique » et dans des environnements similaires durant le Moyen-Âge européen, ainsi que dans les banlieues des sociétés d’Europe de l’Est d’il n’y a pas très longtemps.
Dans ses études, le père Moreno dut se heurter à la problématique de la violence et de la criminalité dans les quartiers populaires ; il réalisa même plusieurs excellentes biographies de personnes ayant commis des délits et des actes violents. Les trajectoires des bandes de Caracas ne sont absolument pas un thème étranger à ce chercheur, qui fait noter combien l’implantation au forceps de logiques individualistes dans les processus modernisateurs du XXe siècle a contribué de façon décisive à l’érosion et à la distorsion des liens de cohabitation dans les quartiers et à l’émergence de processus violents. Et c’est que, aux yeux de Moreno, la logique du « monde de vie populaire » et celle de la modernité sont radicalement distinctes, bien que pas nécessairement incompatibles. Cependant, c’est dans la vie selon les logiques populaires d’affection et de solidarité que cet auteur voit un potentiel de libération pour les pays de « Nuestra América » (10) [Notre Amérique].
Les penseurs modernes – y compris Marx et Engels – ont été généralement peu cordiaux (11) ou, dans le meilleur des cas, ils ont considéré avec énormément de fatalité la destinée des sociabilités antérieures à la modernité. Le Manifeste communiste ne manque pas d’entonner des chants de louange au capitalisme pour avoir permis la disparition rapide des relations inter-personnelles « féodales », que la majorité de ces théoriciens voyaient comme un reliquat du passé ou – à nouveau, dans le meilleur des cas – comme une simple pâture pour nostalgies romantiques. Dans le cas des pays « non industrialisés » (ce qu’on a appelé le « Tiers-Monde »), les gouvernements et autres opérateurs sociaux devraient œuvrer à la disparition des cultures de sociabilité traditionnelle. Ce fut le cas de Sarmiento (12) en Amérique et de Staline en URSS, deux exemples à la fois représentatifs et lamentables des XIXe et XXe siècles.
Bien au contraire du positivisme classique, du libéralisme et du marxisme, les écrivains socialistes libertaires comme Michel Bakounine (13), Pierre Kropotkine et David Graeber (14) ont mis l’accent sur les valeurs de la solidarité, de l’entraide et de l’auto-organisation sociale « par en bas ». Pour eux, les pratiques de ce que Moreno appelle le « monde de vie populaire » peuvent être de véritables embryons de relations sociales plus solidaires et libres que celles qui sont construites selon les logiques individualistes et autoritaires modernes. Les relations communautaires niées par le capitalisme du Nord viendraient ainsi renforcer leurs sociétés respectives avec un principe opératoire que la modernité, à un moment donné, mit sur ses drapeaux avant de l’ignorer systématiquement : la fraternité. C’est le « principe oublié » dont le professeur A. M. Baggio revendique la centralité dans ses recherches.
Pour revenir à notre patrie, l’historien holguinero [originaire de Holguín] José Abreu Cardet estime que dans la guerre de 1868-1878, les relations humaines fondées sur des affects très proches de ceux dont nous constatons (pour le moment) l’existence dans les quartiers habaneros furent un élément-clé pour la survie et le développement de la capacité de lutte des mambises (15). Chose intéressante : de même que dans les cas étudiés par le père Moreno, Abreu Cardet voit une dualité de logiques de relations humaines dans le maquis des mambises, celles qui sont fondées sur l’esprit fraternel de l’affection et de l’entraide (au beau milieu d’un changement drastique qui supprimait radicalement jusqu’aux liens de propriété entre les ex-esclaves et leurs anciens propriétaires), et celles qui avaient pour fondement des notions formelles de type juridique moderne, dans le but d’établir une République avec ses procédures démocratiques correspondantes.
C’est sans doute Joel James Figarola, probablement le plus grand des anthropologues socio-culturels cubains après Fernando Ortiz, qui a défini de la façon la plus audacieuse la signification humaine de la matrice culturelle traditionnelle : d’après James, c’est le lieu où réside la souveraineté nationale. Pour sa part, le poète et essayiste du Cerro Víctor Fowler Calzada a récemment revendiqué le thème à partir de ses expériences vécues et réflexions, dans une série d’écrits et de conférences, publiés pour certains d’entre eux dans la revue Espacio Laical.
La véritable énigme du « monde de vie populaire » est son caractère duel, ambivalent : quelles sont les expériences et quelle est la praxis qui prévalent en son sein – les expériences solidaires et cordiales, de reconnaissance mutuelle comme personnes potentiellement amicales, comme « partenaires », en en venant à la noble extrémité de s’appeler entre nous « famille » ou frères » – ou celles de l’imposition indisciplinée et arbitraire des conduites des uns sur les autres, à la limite de l’autoritarisme et de l’irrespect le plus brutal qu’on puisse imaginer ? Nous trouvons la même ambivalence dans le mot sociolismo (16), si habituel dans les années 70-80 et qui, depuis, de façon significative, a presque disparu de notre langue. D’un côté, il est toujours agréable de se sentir en famille, entre frères ou entre partenaires mais, de l’autre, les liens « naturels » ou « naturalisés » qu’un tel environnement impose peuvent devenir très vite un joug pour tout un chacun ou, si on pousse la thèse jusqu’au bout, ils peuvent tout simplement légitimer l’assaut le plus brutal contre les droits ou les intérêts des « tiers », parmi lesquels le premier affecté est le plus souvent l’État lui-même, qui est en théorie le visage juridique de la collectivité dans son ensemble.
Ce sont là deux faces d’une même monnaie : la dissolution de tout formalisme légaliste face à des normes de comportement que la propre communauté populaire admet et qu’elle avalise contre les règles écrites soigneusement élaborées par les autorités publiques (et au-delà d’elles) en conformité totale avec ce vieux précepte identitaire de la culture juridique criolla (17) : La ley se acata, pero no se cumple [On respecte la loi mais on n’y satisfait pas].
Il s’agit de règles non écrites, extra-juridiques voire contre-juridiques, mais fondées sur la confiance et qui garantissent une certaine prévisibilité des actions des gens. Selon plus d’une étude sociologique, la majorité des Cubains met la famille au-dessus de tout le reste, et nous agissons conformément à ce principe, même au-delà de ce qui relève de la famille au sens strict. Est-ce qu’il ne s’agit pas de cette chose même dont nous, Cubains, nous notons immédiatement l’absence quand nous sommes à l’étranger ? Carlos Acosta, le grand danseur cubain du Royal Ballet, a déclaré un jour dans un entretien accordé à un quotidien de Londres que ce qui lui manquait le plus de la vie à Cuba, c’était de pouvoir frapper à la porte de sa voisine pour prendre un café avec elle. Il avait tout à fait raison : les sociétés du Premier Monde sont régies par des règles formelles dont la domination rejette dans le cadre strictement privé la cordialité informelle de ce cubaneo dont nous jouissons tant ici, dans nos Caraïbes, et que nous critiquons tant. On voudra bien noter qu’il ne s’agit pas en l’occurrence de manque de sociabilité ou d’absence de règles de conduite mais simplement d’une autre sociabilité et d’autres règles. Lesquelles peuvent engendrer d’autres réponses face à des politiques publiques déjà essayées dans le Nord.
L’énigme de l’ambivalence du monde de vie populaire cubaine est mise en évidence avec une netteté exceptionnelle dans la fraternité masculine Abakuá, d’une claire ascendance africaine (carabalí, du Nigeria) mais qui regroupe des hommes de toutes les races, résidant en majorité dans les quartiers pauvres de La Havane, Matanzas et Cárdenas. Il est impossible d’évoquer aujourd’hui comment on construit « par en bas » la sociabilité dans un cadre populaire sans apprécier le double caractère d’Abakuá, caractère qui, d’une part, est assimilé par le peuple (surtout parmi les plus jeunes) à la guapería [truanderie] et, d’autre part, à ce que nous pourrions appeler la vie dans le style du gangstérisme (proche des bas-fonds de La Havane qu’Ortiz commença d’étudier il y a déjà 100 ans), avec le machisme, l’homophobie, la violence et le mépris de toute loi ; et d’autre part, avec les valeurs de « bon frère, bon père, bon ami », une éthique fondée plutôt sur le respect que sur la force, et surtout une culture de résistance populaire « à partir des marges » que tant de patriotes et de créateurs ont donnée à Cuba : Brindis de Salas, Miguel Faílde, Ignacio Piñeiro, Chano Pozo, Jesús Orta Ruiz, Tato Quiñones, les anonymes combattants du maquis mambí ou ces cinq jeunes Noirs inconnus qui tentèrent d’empêcher l’exécution des étudiants de médecine le 27 novembre 1871. Il est fascinant de noter l’interaction du monde Abakuá avec certains projets politiques.
L’hommage public annuel que, depuis 2006, la Cátedra Haydée Santamaría et la Cofradía de la Negritud [Confrérie de la négritude] (deux projets du réseau Observatorio Crítico) dédient à ces jeunes gens qui, tués à coups de baïonnettes, partagèrent sacrifice et fraternité avec les étudiants assassinés, a été une démonstration du profond engagement populaire en faveur de nos idéaux d’émancipation. En tant que participant en presque toutes les occasions, je peux témoigner du caractère massif de ces rencontres, et des larmes des vieux abakuá au moment de la cérémonie liturgique devant le monument qui conserve le morceau du mur où furent exécutés les étudiants de médecine, dont un au moins – d’après ce que nous laisse entrevoir la tradition orale – avait prêté le serment pour devenir un Obonekue (18).
Ainsi, nous pouvons observer un modèle commun dans les façons dont se passe la socialisation dans le cadre de l’ethos populaire, commun à Cuba, à l’Amérique latine, et en un sens aussi, à l’Espagne et à la lointaine Russie. Dans ce dernier pays, qui nous donne une vision privilégiée grâce à une connaissance post festum des dynamiques sociales face à des scénarios de réformes politiques et économiques, il est vraiment surprenant de constater comment on trouve chez les lioubera – un mouvement qui dura moins de 10 ans – des traits éthiques ambivalents, si semblables à ceux des Abakuá cubains. Et le problème est, certainement, le futur de ce type de sociabilité. Alors, qu’est-ce qui est le phénomène le plus persistant : la truanderie ou le patriotisme ?
Crise des valeurs ou crise du sens ?
« Cette vertu publique que, chez les Anciens, on appelait patriotisme procède d’un fort sentiment de notre intérêt propre à la préservation et prospérité de l’ordre libre dont nous sommes les membres », affirma Sir Edward Gibbon (19), historien libéral anglais du XVIIIe siècle, une phrase tirée de son livre Décadence et chute de l’Empire romain. À défaut d’un ferme engagement en faveur de la préservation de l’ordre libre dans la Patrie, le pouvoir passe entre les mains de ceux qui luttent pour de l’argent (les mercenaires), comme cela eut effectivement lieu à Rome : tel est l’enseignement principal de cette œuvre monumentale. Au sein du séminaire de La Havane, avec ou sans influence de Gibbon, le père Félix Varela (20) expliquait en 1818 : « L’amour que tout homme a pour le pays où il est né, et l’intérêt qu’il prend pour sa prospérité, nous l’appelons patriotisme ». De la sorte, la dimension sensible et affective (21) de l’amour prenait place auprès de l’intérêt rationnel, mais sans le supprimer. Comment pouvons-nous préserver et faire croître le patriotisme dans notre Casa Cuba ?
En analysant les deux définitions, il nous faudra d’abord partir de l’amour à la Patrie, dont il existe déjà suffisamment de preuves, en elle et hors d’elle ; mais, en outre, nous devrons susciter chez nous un ordre libre, dont le but serait de veiller à l’intérêt et à la prospérité de tous les Cubains. Il s’agit d’une synergie, où la vertu, animée en même temps par l’amour et la conscience de l’intérêt qu’elle y a, vise à la pleine jouissance d’un ordre social libre. Gibbon et Varela parlent implicitement de sens, c’est-à-dire précisément de cette synergie que nous avons à l’esprit. Que de complexité dans les termes de Gibbon et de Varela, et que de clarté, si éloignées des ritournelles courantes sur la « crise des valeurs » ! Apprécier le monde à partir de la catégorie de sens revient à s’émanciper de sa fragmentation, puisque cela signifie construire et lancer des ponts entre les structures de la société et le monde intérieur intime de ceux qui les habitent (puisque le sens est aussi quelque chose de ressenti). Dans cette perspective émancipatrice qui promeut l’efficacité, le regard de l’observateur acquiert un tranchant critique et une habileté utile au changement : « L’actuel n’est pas ce qui est présent, l’actuel est ce qui agit. »
Ici, nous approchons de notre propos critique central, de la thèse que je désire défendre dans cet essai. C’est la critique de l’ignorance du sens : la critique de cette vision partielle, individualiste et étatique, qui conçoit l’État et/ou l’éthique (les « valeurs ») et/ou la culture même dans son ensemble, comme un ornement ajouté à un système économique tenu pour neutre du point de vue des valeurs. Mais nous savons que les systèmes économiques ne sont pas ainsi, puisqu’ils structurent l’esprit humain et, bien entendu, l’éthique également, à partir de principes (prétendument anthropologiques) bien déterminés, même si ceux-ci ne sont pas énoncés explicitement. Et, par ailleurs, comme y insistait Marx lui-même dans sa critique de Hegel, il est utopique d’imaginer un État « pur », une éthique « pure », une culture « pure », indépendantes du système économique, d’autant que l’économie est le soutien de l’État lui-même, de l’éthique et de la culture. Et cela inclut, bien entendu, toutes les règles qui ne sont pas conçues « d’en haut » (22).
C’est ainsi que comprendre le patriotisme comme sens – l’amour du pays et de l’ordre libre – nous amène à la création institutionnelle de la patrie (pas nécessairement étatique (23) : l’organisation que doit adopter notre environnement social en vue de la coordination des intérêts (et des agendas politiques) personnels pour le succès des objectifs partagés « avec tous et pour le bien de tous ». Et de là nous allons aux règles (non seulement les étatiques ou celles qui sont adoptées « d’en haut » ; au point où nous en sommes il doit être clair pour tous que ne s’intéresser qu’aux seules règles formelles du droit n’aide pas à l’analyse de la situation réelle d’une société, de ses « facteurs réels de pouvoir »). Selon le sociologue du droit argentin Enrique del Percio, « l’existence de la norme dépend de multiples facteurs de type essentiellement culturel, politique et économique », et, avec cet auteur, nous ferons une brève incursion sur le thème des impôts, si important pour la question de savoir comment on partage les ressources disponibles dans une société.
Del Percio considère le droit fiscal comme « une question fondamentale pour la marche de l’État » et une sorte de pierre de touche pour aborder la diversité des systèmes de normes et des cultures civiques dans toutes sortes de communautés humaines. Dans ce but, dans son livre Política o destino, il nous offre ce témoignage fascinant : « Je donnais des cours à l’Université technique de Dresde et, une nuit, alors que la température était de plusieurs degrés sous zéro, j’étais allé dîner avec Joachim Born, un professeur réputé de cette institution. À la fin de la soirée, apparut la typique discussion sur le point de savoir qui devait payer la note. Mon collègue allemand argumenta qu’il devait le faire, lui, puisque le fisc lui retenait tous les mois 40 % de ses revenus, mais qu’à la fin de l’année il lui restituerait un pourcentage similaire à cause des frais que son travail aurait pu lui occasionner. C’est ainsi que, en présentant des factures pour l’abonnement à une revue scientifique, pour l’achat d’un livre ou d’un ordinateur, pour avoir assisté à un colloque ou, comme dans le cas présent, pour être allé dîner avec un autre enseignant pour discuter sur des questions relatives à son travail, a la fin de l’année le fisc verserait sur son compte en banque jusqu’à 40 % de ces dépenses. Avec une pure logique latinoaméricaine, je lui demandai comment le fisc pouvait savoir que la facture du restaurant témoignait qu’il était allé dîner avec moi et pas avec sa femme. Joachim me regarda d’un air étonné et, sans comprendre le sens de ma question, il me répondit : “Eh bien, parce que si j’étais allé dîner avec ma femme, je ne présenterais pas la facture au fisc !” Je fis alors un commentaire d’autoflagellation assez évident autour des problèmes qu’entraîne dans nos sociétés le fait d’être si peu portés à respecter strictement la loi, mais aussitôt il me fit remarquer que, dans les questions sociales, rien n’est tout à fait blanc ou noir : il se contenta de me rappeler que, il y a un peu plus d’un demi-siècle, la loi allemande indiquait qu’il fallait exterminer les juifs et que la majorité des Allemands agit dans le respect de ces règles… Si on laisse de côté ces dernières considérations, on peut parier que le lecteur se souviendra de quelque anecdote de ce genre ayant pour acteur un autre Allemand, un Anglais, un Suédois ou un Français. Il est très probable qu’il aura également écouté un Nord-Américain s’exclamer : “Mais moi, je paie mes impôts!” quand il s’agit de défendre ses droits. Il y a peu de chances qu’il se rappelle une anecdote de ce genre concernant un Andalou, un Équatorien, un Panaméen, un Napolitain ou un Argentin. Il y a plus : dans ce dernier cas, il est plus que probable que le lecteur a à l’esprit quelque récit sur les mille astuces dont on se sert pour éluder, voire purement et simplement pour ne pas payer, tel impôt, un récit raconté avec fierté par l’auteur même de l’infraction. »
Ensuite, le professeur Del Percio relate comment dans ses aventures académiques de sociologue du droit, il fut surpris de constater l’absence virtuelle d’investigations relatives « aux différentes conduites fiscales de la part des différents peuples » ainsi que par le fait – partagé par lui avec ses étudiants les plus avancés « dont de nombreux fonctionnaires du gouvernement ou du pouvoir judiciaire et des conseillers des législateurs » – « que, au moment de faire des recommandations, les fiscalistes des nations andines ne se soucient guère d’aborder le contexte socioculturel de la problématique fiscale mais qu’ils tendent à prendre comme modèles les systèmes fiscaux européens ». Le thème des motivations sociales (du sens, dirions-nous) des conduites au moment de payer (ou pas) les impôts n’est « étudié à fond » par aucun classique » « et les sociologues contemporains ne le mentionnent même pas ». « Les versions existantes de ce que nous pourrions appeler la “sociologie des Finances publiques” pèchent par leur eurocentrisme exacerbé. En effet, on remarque toujours une conception anthropologique sous-jacente selon laquelle l’être humain est identifié au sujet européen moderne (bien entendu, on inclut sous ce concept les Nord-Américains blancs), et les critères de son action sont régis par la même logique inhérente aux critères occidentaux de rationalité. Ces versions ne nient pas l’existence d’autres idiosyncrasies mais elles affirment que ces façons d’être s’expliquent parce qu’il y a des peuples qui ne sont pas “encore” parvenus au niveau de développement ou de progrès propre aux peuples européens. C’est pourquoi leurs enseignements sont partiellement valables dans la mesure où ils se réfèrent à ce que la condition humaine a d’universel, mais en revanche ils ne nous sont d’aucune utilité pour rendre compte de ce que chaque peuple a de particulier et de spécifique ». Autrement dit, ils sont d’une utilité limitée ou nulle quand on doit affronter un problème réel et concret (24), comme, par exemple, la construction de notre Casa Cuba.
Le professeur Del Percio en conclut que « cette situation peut s’expliquer par le fait que les pays centraux ont construit peu à peu leur structure fiscale à partir de la perception directe du type de subjectivité constituée par leurs citoyens, sans qu’il soit besoin de théoriser sur le sujet, et nous en général nous nous contentons d’étudier cette production théorique et – dans le meilleur des cas – nous essayons de l’adapter à notre réalité avec assez peu de succès. Les Latinoaméricains et les Européens sont différents. Ni meilleurs ni pires les uns que les autres : différents. C’est pour cette raison que Simón Rodríguez, le maître de Bolívar, a pu dire que si, nous, Américains nous n’inventions pas, nous mourrions. Nous ne pouvons copier de manière acritique les institutions d’autres pays pour le simple fait que, dans ces pays, elles marchent bien. Il n’est pas question non plus de faire table rase de ce qui a été expérimenté et pensé sous d’autres latitudes ou de faire mine de l’ignorer. Il s’agit, en revanche, d’adopter une attitude mûre et responsable qui saurait reconnaître les les facteurs déterminants dans la constitution de subjectivités différentes pour agir en conséquence. En effet, ce qui est donné pour acquis en d’autres lieux – et qui ne vaut pas la peine, par conséquent, d’être analysé en détails – requiert une analyse particulière chez nous en raison de notre spécificité en tant que société ». Pour ma part, je résumerais volontiers toutes ces remarques en une seule phrase : pour avoir du sens, la loi doit donner un visage à la communauté.
Le visage social/humain des réformes : « culture fiscale » vs. « l’amour comme stratégie politique » ?
Les idoles des païens, or et argent, une œuvre de main d’homme !
Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas.
Elles ont des oreilles et n’entendent pas, pas le moindre souffle en leur bouche.
Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi.
Psaume 135 (134)
L’incivilimento (25) progressif de l’être humain consiste en sa libération à l’égard des idoles… Parmi les idoles de l’homme d’aujourd’hui, l’une des plus persistantes et malignes est l’État.
Norberto Bobbio
Au sujet de cette approche du chercheur argentin, il me vient à l’esprit la réponse, en direct à la télévision, de notre ministre des Finances et des Prix à la question d’un journaliste à propos de l’existence (ou de l’inexistence) de la culture fiscale à Cuba. La haute fonctionnaire répondit ceci : « Chaque fois que je rencontre des ministres des Finances d’autres États, ils me disent que dans leurs pays il n’existe pas non plus de culture fiscale… »
Il est évident qu’il est difficile d’obliger ou de persuader quelqu’un de payer le fisc (à Cuba, la situation est encore plus compliquée par l’invisibilité virtuelle des impôts pour la majorité des citoyens depuis les années 60) ; cette intromission de l’État dans la vie des gens a généré des attitudes variées tant parmi les collègues de l’évangéliste Matthieu comme chez ceux de Robin Hood. La majorité des États actuels (et c’est là-dessus que se fonde la « culture fiscale ») pratiquent une sorte de « pacte social » où le contribuable paie mais où l’État s’engage à agir conformément à la décision des majorités, et en respectant les droits constitutionnels des minorités (tout l’appareil des finances publiques et les décisions budgétaires vont dans ce sens). C’est pourquoi, dans le cadre fiscal des États « sociaux », convergent « officiellement » la solidarité matérielle avec celui qui a moins et l’imposition de la volonté par un gouvernement : un modèle obligatoire de solidarité soutenu par des règles démocratiques. Est-ce qu’un tel « pacte » est viable à Cuba ?
Si nous partons du modèle de pensée hérité, la réponse est « oui ». Le problème serait de parvenir à établir une « plus grande culture fiscale », à élever la discipline, l’honnêteté des contribuables et des fonctionnaires, la transparence du système dans son ensemble. Cependant, si on regarde les choses comme elles sont, est-ce que les gens font vraiment confiance aux fonctionnaires qui contrôlent les impôts ? Et, surtout, est-ce qu’ils se fient à l’usage qu’on fait a posteriori de l’argent recueilli ?
Étant donné l’existence du mensonge endémique et de l’habitude invétérée de commettre des actes illégaux (26) (il n’est un secret pour personne qu’une grande partie de l’économie domestique des familles cubaines et certainement une énorme fraction du secteur « formel » fonctionne hors des lois « officielles » : qu’on pense, par exemple, à la manière de se procurer du lait pour les enfants ou quelque pièce mécanique destinée à un omnibus du secteur étatique qu’on ne peut obtenir en suivant « les circuits établis »), une bonne part des ressources et des influences sont régies à travers ce dense réseau de relations qui constitue le « monde de la vie populaire ». Et les modes traditionnels de décision n’intègrent pas encore – en dépit des exigences croissantes dans le sens contraire – la « population » mais seulement les cadres et autres fonctionnaires de différents niveaux. Autrement dit, il existe une haute probabilité qu’un tout récent cuentapropista [auto-entrepreneur] préfère entrer dans des relations de « partenaires » avec les fonctionnaires qui le contrôlent, ainsi que recourir à des « partenaires » d’un autre genre pour satisfaire ces besoins que l’État ne peut pas satisfaire. C’est ainsi qu’une grande part des ressources qui devraient revenir au budget s’échappe par des voies informelles, et que s’établit un cercle vicieux reproduisant à l’infini de telles relations.
Bien sûr, il y aura des gens pour dire qu’il s’agit d’une situation absolument anormale, issue d’une mauvaise gestion, ou d’un système économique inefficace, ou d’une économie viciée à la racine, ou d’un mal « endémique » propre aux Cubains comme ethnie. Ce sain non-conformisme doit être salué, mais la question reste posée : que peut-on y faire ?
Ce qui est vraiment « utopique », ce serait d’imaginer la possibilité de voir soudain émerger un État « pur », indépendant des réalités existantes, dont, comme je l’ai déjà dit, le système économique – le « réellement existant » – qui est le soutien de tout le système mais qui, à son tour, parvient à fonctionner grâce à une série de règles (qualifiées parfois, de façon sans doute trop étroite, de « culture ») que les gens ont intériorisées dans leur vie de tous les jours.
En particulier, les gens eux-mêmes, les fonctionnaires, est-ce qu’ils seront différents ou est-ce qu’ils changeront du jour au lendemain ? Existe-t-il des raisons pour penser que, une fois « transformé », « rénové » ou « actualisé », le nouveau modèle sera plus crédible que l’actuel ? Quels processus auront lieu durant cette « actualisation », et comment les contrôler ? On pourra peut-être recourir à un nouveau discours politique, ou à de nouvelles mesures politiques (de quel type, nous en parlerons à la fin de cet essai) et économiques qui tourneraient directement à l’avantage des citoyens. Cependant, un tel discours et de telles mesures n’auraient pas d’effets instantanés, et on peut suggérer que la plupart des problèmes sociaux à long terme sont précisément l’effet de conséquences imprévues surgies au cours des états intermédiaires des processus de changements sociaux : on n’arrive pas instantanément à la fin recherchée, le chemin est dur, et comme on est souvent obligé de faire la route dans l’autre sens, les conséquences en sont parfois néfastes. Comment pourraient se concrétiser les changements au niveau de la réalité « réelle », quotidienne, de chacun, dans son terroir, ou au milieu des immeubles de La Havane si souvent transformés en ruines ou encore dans les montagnes où parfois il n’y a pas moyen d’obtenir les choses élémentaires les plus indispensables à la vie ?
Rien que le thème des impôts (mais il y en a bien d’autres), considéré dans sa contradiction (solidarité contre imposition) essentielle et dans toutes les contradictions pratiques/vécues qui lui sont associées dans notre vie quotidienne, est suffisamment complexe et éclairant pour que nous nous rendions compte que, pour parvenir à n’importe quel état souhaitable à partir de l’actuel, il faut passer par toute une série d’étapes, avec le même peuple qui habite aujourd’hui notre île, et qu’il est impossible que les nouvelles institutions – et surtout les nouveaux fonctionnaires qui les soutiendraient (ainsi que les nouveaux travailleurs, les nouveaux contribuables, les nouveaux citoyens en général) – se matérialisent parmi nous à partir du néant, comme un dieu antique descendant sur la scène par le moyen d’une machinerie.
Cette considération est importante pour parvenir à juger d’un oeil critique la vision la plus acceptée de Cuba à moyen terme, où on prévoit en même temps réduire les effectifs de l’État et ses institutions et promouvoir certaines formes de micro-entreprises qui incluent la possibilité d’utiliser une force de travail salariée (dans la restauration cuentapropista [pour son propre compte], par exemple, on a choisi de rendre obligatoire l’embauche de salariés, en écartant d’autres formes plus horizontales d’organisation productive, comme les coopératives). Alors que, à la télévision, on célèbre les grands succès obtenus par des paysans usufructuarios [ceux qui ont la terre en usufruit] aux côtés de leurs journaliers, lesquels « travaillent bien parce qu’on les paie bien », il convient de rappeler que les relations salariales sont toujours construites comme des relations hiérarchiques et autoritaires, où un des deux termes de la relation a bien plus de pouvoir que l’autre (celui-ci est généralement exclu de la prise de décisions quant aux conditions de travail et la gestion de l’affaire en général).
Une telle situation se complique sur le plan politique parce que, comme le signale bien l’activiste Yasmín Silvia Portales, « nos projets institutionnels doivent être réalisés en quelque dépendance de l’État ou ils atomiseront (les gens) au maximum, parce que dans la logique officielle, il n’y a qu’une identité : la nationale. Alors, sans transformer le modèle qui régit la politique cubaine des associations, on ne pourra pas faire admettre que les personnes ne se lient pas seulement pour des raisons professionnelles, spirituelles ou politiques, mais aussi parce qu’elles sont victimes de la discrimination et que cela est une raison pour se retrouver, une méthode légitime pour s’émanciper (27) ». Ainsi, l’étatisme et le libéralisme « dans leur état pur » sont tous deux des visions qui tiennent l’économie et les réalités associatives « spontanées » pour des choses séparées, ce qui conduit à les ignorer ou à les mésestimer, en favorisant du coup l’atomisation sociale.
Si on doit en croire les réflexions de notables économistes, le débat semble se diriger vers l’idée selon laquelle Cuba requiert une économie mixte avec une forte présence du secteur privé (probablement renforcé avec les investissements de certains Cubains vivant aujourd’hui hors du pays). Une variante plus « dure » semble être la promotion du projet classique de l’« État démocratique de droit » avec une « économie sociale de marché » qui évite les excès autoritaires et ploutocratiques, en garantissant la paix, le consensus et en définitive une maison commune pour tous les Cubains. Les promoteurs de ces projets, qui se présentent comme réalistes, se montrent sceptiques devant d’autres variantes, comme celles qui sont fondées sur l’autogestion des moyens de production par les travailleurs eux-mêmes, la création d’entreprises coopératives, et la conscience claire que, même sous sa forme la plus rudimentaire, et même si elle résout une série de problèmes, l’entreprise privée en engendre bien d’autres, dont le plus persistant est l’aliénation du producteur direct et l’activation de forces virtuellement incontrôlables. Il faut dire cependant qu’il est évident que la traditionnelle économie étatisée et centralisée n’est pas moins problématique.
D’autres proposent l’économie capitaliste comme la seule possible et nécessaire pour le Cuba du futur, à partir de notions issues de la théorie de la complexité, de l’efficience, du dialogue et de la diversité, de la liberté, des droits des minorités, etc. Pour ceux-là, la liberté est synonyme de capitalisme, une thèse fondée sur l’idée rebattue selon laquelle « chaque personne » (c’est-à-dire l’individu humain, tel que le voit le libéralisme) peut être un entrepreneur s’il possède suffisamment de talent et d’initiative. Outre le pouvoir des oligarchies ploutocratiques dans n’importe quelle partie du monde, ceux-là oublient aussi que le capitalisme actuel n’est plus ce qu’il fut au XIXe siècle, qu’il est devenu bien plus impersonnel que celui-là, puisque pour les entreprises par actions la mathématique, calculable et « objective » notion de gain devient bien plus puissante que la volonté de n’importe quel entrepreneur individuel, la personne du capitaliste lui-même passant au second plan. Le système global est régi par des flux de capital, lequel apparaît de plus en plus comme un sujet autonome globalisé. Et la globalisation est promue habituellement comme quelque chose d’inévitable.
Ce projet d’« économie de marché solidaire », dotée d’un « bilan de régulation étatique, à côté de programmes de justice et de solidarité sociale », est résumé par un commentateur dans les brèves paroles qui suivent : « La base de cette structure économique est la propriété privée, l’existence d’un groupe d’entrepreneurs avec une conscience sociale, l’investissement étranger sous forme de capital mixte avec des entreprises privées cubaines, le développement industriel et urbain des provinces, la décentralisation du gouvernement, une excellente éducation des nouvelles générations, la discipline sociale et l’obéissance consciente à la loi et l’ordre de tous les citoyens et leur classe politique. Cela ouvrira un grand futur pour notre pays. Tout cela peut être atteint sans problème et n’est pas une utopie sans fondement. » Est-ce que cela est vrai ?
Je ne voudrais pas jouer les trouble-fête, mais il me semble que ces projets (celui de l’« actualisation du modèle » dans sa version actuelle et celui de la transition au capitalisme) présentent deux problèmes. Un problème de fond, d’abord : ils conçoivent la spiritualité comme un simple ornement chargé d’embellir une économie qui ne se soucierait que de l’intérêt individuel et de l’imposition autoritaire étatique. Ici, nous courons le risque d’être traités d’utopistes, mais en prenant position en tant que chrétien et révolutionnaire, je préfère être l’un et l’autre complètement et pas à moitié, être un homme croyant aux personnes en tant qu’elles sont l’image de Dieu, à l’amélioration humaine par la voie de la communion dans l’action et aux possibilités du changement radical de la société vers un état plus solidaire, « contre les dominations et les puissances de ce monde ». L’autre problème est d’une nature pratique et culturelle (bien que, étant réaliste par vocation, je perçois que, dans le fond, il est consubstantiel au problème antérieur, l’essence de l’être humain étant la capacité de nouer des relations sociales avec les autres) et il découle de toute notre réflexion antérieure. Imposer des règles sociales par l’entremise du pouvoir étatique s’avère peu efficace, comme le démontre l’histoire cubaine récente. Mais pas seulement celle de Cuba : en 2010 le monde entier a été surpris de voir que, dans une nation traditionnellement tenue pour respectueuse de la loi et considérée comme un véritable parangon en matière d’éthique publique, de vertus domestiques et connue pour ses bas niveaux de corruption – je me réfère au Japon –, on avait révélé l’existence de milliers de cas de fraudes aux retraites, à savoir que les familles de retraités morts depuis quelques années avaient continué de toucher les pensions de retraite pendant des décennies (on a même dit que ces fausses statistiques auraient affecté les chiffres de la démographie japonaise). Et ne parlons même pas de cultures plus proches de nous : les maras d’Amérique centrale et la guerre contre le crime et la corruption au Mexique occupent la une des journaux tous les jours.
Quand l’État se replie, l’« autogestion » adopte des formes informelles, semi-clandestines, subalternes, dominées par le marché bien que non réductibles à lui : des formes privatisées, la société s’atomisant une fois que les liens construits « d’en haut » commencent à se défaire. Les gens construisent leurs alternatives organisationnelles « par en bas », mais en opérant en marge des relations formelles et de la légalité, ces formes alternatives se caractérisent par la précarité et leur caractère excluant. L’essor d’un imaginaire privatisé, sans que la solidarité ne trouve une expression institutionnelle adéquate, conduit à la violence, et alors l’État rend les coups en prenant des mesures répressives, qui engendrent néanmoins un consensus favorable à l’imposition de l’ordre par la force, contre les groupes désignés comme causes de la violence. On peut avoir à affronter alors des situations désagréables, quand, par exemple, les majorités sociales troublées peuvent consentir à un Pinochet. Ce n’est pas par hasard si de nombreux défenseurs du libéralisme saluent la possibilité de le voir advenir sous l’égide d’un État autoritaire. Dans ce cas, la situation d’aujourd’hui est impossible : la promotion du libéralisme sans l’invocation d’une répression explicite, qui se présente sous le déguisement d’une liberté sans adjectifs. L’ouverture conduit à la fermeture ; du reste, de plus en plus d’espaces sociaux sont restreints et fermés. Il commence à être évident pour tous que, dans les sociétés fondées sur la propriété privée, la liberté et l’ordre ont aussi leur maître.
Notre Casa Cuba peut adopter une géométrie aussi imprévisible que celle de la figure géométrique du film Cube (28) :
1. On assiste à l’apparition et/ou à l’élargissement de nouveaux secteurs privilégiés, soucieux du maintien commode de leurs privilèges (la commodité inclut d’ignorer/d’écarter ceux qui ne les ont pas).
2. Face à tout cela et au possible sous-emploi ou chômage endémique, surgit la nécessité de l’exclusion (de facto) urbaine, raciale, régionale, classiste, de genre : la gentrification.
3. Résistance (y compris violente : les bandes) à cette exclusion, et nécessité de la « naturaliser », de l’entretenir, de la « juridiciariser » au besoin.
4. Corruption des contrôleurs et collecteurs des impôts (manque de transparence et pouvoir mafieux contre efficacité rationnelle de la bureaucratie), avec le concomitante manque de crédibilité dans les décisions publiques, puisqu’en outre personne ne parle de démonter les privilèges et de socialiser les décisions.
5. Le nihilisme juridique est un obstacle à la production de consensus et de cohésion sociale, et à l’attaque « légale » contre la violence « d’en haut ».
6. Relation (potentiellement violente) bandes – affaires privées – corruption : surgissement de mafias locales.
7. Crise générale terminale de la crédibilité et fragmentation de l’imaginaire national.
8. À cause de tout ce qui précède – et qui est responsable d’une crise du sens – et de l’augmentation de la violence « d’en bas », nécessité de recourir à la violence « d’en haut », en faisant sortir l’armée dans les rues. Ainsi, les privilèges ploutocratiques nés de l’accumulation non socialisée de ressources sont synonyme d’inégalité rampante et d’exclusion du plus grand nombre, en suscitant la résistance des groupes subalternes ainsi que la nécessité de leur classement (racial, culturel, territorial, régional, urbain, etc.) et imposition d’une dure discipline (violente au besoin). De surcroît, le scénario analysé inclut d’importants effets sur la subjectivité de ceux qui habitent la Casa Cuba.
9. L’attitude consumériste généralisée ôte toute crédibilité aux positions sociales (agendas politiques personnels) critiques, créatives et réflexives.
10. L’aliénation économique est source de discordes, de recherche d’échappatoires et d’apathie morale.
La crise économique n’est pas seulement manque de ressources ou d’alimentation ; elle est manque d’activité, de « protagonisme » dans l’économie, manque d’espaces de créativité. Nous sommes d’accord là-dessus avec les libéraux, mais eux doivent apprendre à se souvenir que l’être humain n’agit jamais seul. C’est pour cela que l’idée que nous avons d’une sortie de crise est très différente de la leur : nous, nous mettons l’accent sur la coopération et la socialisation. Quand on considère que l’« économie » est plus qu’avoir ou ne pas avoir de l’argent mais qu’elle est un véritable univers de production et de gestion produisant des règles éthiques et les possibilités réelles de vie (ou de mort) sociale, on en vient à l’idée que la résolution de la crise éthique est indissolublement liée à la résolution de la crise économique. Et pas seulement dans le sens d’« améliorer le niveau (ou la qualité) de vie (ou du développement humain) », mais dans un sens bien plus profond, comme l’explique Mario Castillo : « N’oublions pas que le libéralisme classique, le néolibéralisme (et le néolibéralisme qu’on est en train de relancer à Cuba) ferme les yeux sur l’analyse des conséquences psychosociales du travail salarié et rendu invisible le fait que le code de gouvernance à l’état pur – depuis la plus petite boutique de cordonniers salariés jusqu’à une industrie de technologie de pointe – repose sur l’autocratie de l’administration/patron qui se passe, chaque fois qu’elle le peut, de la division des pouvoirs et du système représentatif qui est si cher à la démocratie, et auquel les socialistes autoritaires, de Lénine jusqu’à Che Guevara, n’ont rien apporté de nouveau (29). » Est-ce que nous allons continuer, alors, de vivre dans un univers social où la subordination est vue comme un fait inévitable et naturel ou allons-nous faire un saut vers une liberté responsable ? Où nous mènent les libéraux et les technocrates ? Où nous mène la métaphore de la Casa Cuba, comprise comme espace de partage des libertés ? Comment faire que l’ouverture de certains espaces n’entraîne pas notre désespoir devant toutes les portes qui restent fermées ?
Quelles sont, par conséquent, les options spirituelles que nous avons à notre disposition pour aménager notre Casa Cuba ?
1. Regarder comme « naturelles » les inégalités émergentes et les tensions que celles-ci génèrent. Cette projection inclurait des variantes comme le fatalisme, le racisme, l’infériorité de certaines personnes par rapport à d’autres, l’eurocentrisme culturel, la « naturalisation » de la pauvreté: tout cela conduirait à considérer le « monde de vie populaire » comme un non-sens dans l’ère présente, ou, sur le plan éthique cette attitude qui consiste à penser qu’« ils ont ce qu’ils méritent ». Parce qu’elle est excluante et ségrégationniste, cette option n’est pas compatible avec les stratégies politiques de l’amour.
2. L’autre option est « faire confiance au progrès », avec toutes sortes de variantes : un léninisme de marché actualisé ou des modèles « démocratiques »-(néo)libéraux ou d’économie sociale de marché/État démocratique de droit), avec un abîme entre les subjectivités (mentalités, valeurs) « retardataires » et les « lois » objectives. Les deux options présument que les universitaires, les planificateurs et décisionnaires savent ce qu’il faut faire et les autres non. Pour ceux qui sont épuisés par l’endoctrinement « collectiviste » imposé du haut, existe alors (a) la variante du deus ex machina, l’idée selon laquelle « eux » (le gouvernement ou les ex-émigrés) finiront par tout arranger ou (b) rendre les gens conscients de ce que il n’existe pas d’autres « racines du changement » hors de nous-mêmes. Cela nous amène à considérer le « protagonisme » démocratique du peuple.
Pour une « Casa Cuba » sans chambres pour les domestiques : valeurs et sens du « protagonisme » du peuple
Yo quiero en juego franco
Del pensamiento sin tasa
Ver fabricando la casa
Rico y pobre, negro y blanco.
José Martí
Voir l’être humain comme acteur de la politique, comme un être qui a besoin d’être aimé et capable d’aimer, qui voit dans la politique un des aspects possibles et nécessaires de ses capacités, une perspective qui, pour l’essentiel, s’oppose à celle qui voit dans ce même être humain un atome comptable d’une « population » (d’habitants, de travailleurs, de clients, etc.). Cette approche en termes de « population » est typique des gestionnaires capitalistes mais aussi des systèmes d’État qui ont prétendu construire le royaume des cieux sur Terre par des « orientations » d’en haut et une obéissance aveugle en bas. Le « protagonisme » démocratique du peuple est aussi une « stratégie politique de l’amour », qui met l’accent sur la radicalité de la démocratie et de la liberté humaine au-delà des limites assignées par le libéralisme et le capitalisme en général, et également à rebrousse-poil des modèles étatistes.
Ce à quoi n’est pas parvenu le socialisme d’État dans ses divers modèles est au fait que les collectivités humaines décident par elles-mêmes leurs stratégies publiques, en chargeant du fardeau des décisions les épaules d’une nomenklatura par définition séparée de la société et de plus en plus isolée des communautés où coexistent les personnes (en formant en définitive des communautés élitistes pour leur propre cohabitation et leur auto-socialisation comme classe). Parler d’inclusion et de solidarité est par conséquent parler de plus en plus de « protagonisme » personnel/social, de la socialisation de la prise et de l’exécution des décisions, parce qu’on ne peut rien socialiser effectivement si ce faisant on ne personnalise pas chaque être humain. Dans l’étatisme, l’État décide de tout, et dans le capitalisme, la démocratie s’achève aux portes des usines. À la différence du libéralisme et de l’étatisme, qui séparent et atomisent, le « protagonisme » socialise et personnalise la gestion de la société entière vers tous ses composants humains. Qui prend les décisions personnellement/socialement relevantes, et qui les exécute, devient par conséquent la question-clé, la pierre de touche du « protagonisme » populaire. Et les traits du monde de vie populaire (comme sa capacité de solidarité et d’autogestion) deviennent tout spécialement importantes. Cela étant dit, je crois nécessaire de remettre au goût du jour une notion essentielle, que j’oppose à celle de gouvernance. C’est la vieille notion de l’Ordre (Ordnung en allemand ancien) : rappelons l’« intérêt propre qu’on prend à la préservation et à la prospérité de l’ordre libre dont nous sommes les membres », de Gibbon. On nous reproche à nous, les libertaires, un mépris congénital pour l’ordre social. Or rien n’est plus faux ! L’ordre qu’on respecte spontanément est le plus solide qui soit. Les institutions historiques du monde de vie populaire (ou ce qu’il en reste) ont beaucoup à voir avec cette question. Pour les réactiver, il faut que les questions publiques deviennent les préoccupations personnelles pour les citoyens (familles, habitants des quartiers, travailleurs, consommateurs, etc.) ; le mise en ordre de la gestion des objectifs partagés doit être construite d’une manière différente à l’atomisation libérale et à la hiérarchie autoritaire-étatiste, ainsi qu’à ses variantes mixtes et light :
1. Créer un réseau de coopératives de consommateurs rendrait plus léger le poids du système de commerce intérieur et encouragerait un contrôle d’en bas sur la gestion commerciale et la satisfaction des besoins de base.
2. Remplacer les impôts versés aux caisses centrales de l’État par le partage des quotas progressifs décidé d’un commun accord, où chaque contribuable déciderait dans une déclaration faite sous serment de la destination de son argent, transformerait le système fiscal en un véritable instrument d’autonomie solidaire.
3. Organiser de manière participative les budgets comme cela se pratique d’ores et déjà dans certaines villes de notre Amérique.
4. Remplacer l’organisation verticale des entreprises étatiques par une véritable autogestion des travailleurs et des habitants des quartiers à tous les niveaux.
5. En particulier, transformer les grandes chaînes touristiques, les entreprises qui rendent des services publics et d’autres de portée nationale en sociétés anonymes ayant les municipalités (ou conseils populaires) pour actionnaires (selon des quotas proportionnels à leurs populations).
6. Et que ces entités territoriales puissent former des fédérations pour résoudre en commun leurs problèmes communs.
7. Promouvoir une véritable liberté d’expression, de création et d’autoorganisation dans un environnement de respect à la diversité culturelle du peuple cubain, tels sont seulement quelques-uns des remèdes possibles contre la dégradation de notre ethos social.
Comprendre la souveraineté populaire/nationale comme synonyme de l’exercice total des droits humains par tous les citoyens sur tout le territoire du pays sera l’effet réel de ces procédures et la condition de la conservation de l’ordre et la paix à Cuba. Insister sur le réalisme de la promotion de variantes de l’économie et de politiques solidaires (autogestion sur le lieu de travail, coopératives, auto-entreprises, budgets participatifs, auto-gouvernement communautaire), ne signifie pas nier la possibilité que celles-ci opèrent dans un économie mixte. Reconnaissons que à Cuba et dans le système-monde actuel (c’est-à-dire capitaliste), la propriété privée fait inévitablement partie du panorama. Ce qui me paraît important, en revanche, c’est que cette dernière n’impose pas la logique générale du système. Cependant, si elle peut représenter dynamisme, initiative, esprit entrepreneurial et, à la longue, un droit humain (des épithètes qui valent également pour les autres formes que nous avons mentionnées), cela cesse d’être vrai quand on passe des entrepreneurs individuels aux grandes sociétés.
Un argument conservateur alternatif serait que – étant donné la détérioration actuelle de l’ethos et du civisme –, la seule alternative viable à la démocratie socialiste/personnaliste (alternative utile pour ceux « d’en bas » en cas de transition au capitalisme) est la gouvernance par la répression. Pour nous, une telle démocratie permet une issue pacifique et cordiale à la crise, puisque le capitalisme éloignerait immédiatement le pays de la possibilité d’un ordre non ploutocratique, via des explosions sociales et la répression subséquente qui mènerait Cuba à la condition classique d’un État manqué. Nous ne pouvons importer les institutions de la Suède ou de la Chine, puisqu’il faudrait remplacer les habitants de notre archipel par les natifs de ces pays. On pourrait continuer d’argumenter pour savoir où est la réalité et où l’utopie mais je préfère recourir à un professeur libéral italien du XXe siècle : « Nous savons aujourd’hui que la démocratie progresse non pas tant en proportion avec l’extension simplement quantitative du suffrage que proportionnellement à la multiplication des institutions d’autogouvernement (30). » Ce même auteur écrivit longuement sur la coutume démocratique comme la véritable base d’une Constitution.
De sorte que la pratique constante des libertés, la liberté personnelle de chacun, solidaire des autres (la seule façon de faire que le mot « socialisation » ait un sens), est la garantie de l’apprentissage des libertés elles-mêmes et d’une vie éthique de coexistence. C’est cela qu’ont affirmé des penseurs laïques séculiers, depuis Emmanuel Kant jusqu’à Rosa Luxemburg et Cornelius Castoriadis. C’est ainsi qu’on peut mettre sur pied une stratégie politique pour l’amour.
Équité, « protagonisme », éthique : sens d’une métaphore
Conduire la société à la justice sociale n’est pas résoudre de façon optimale le problème d’une « juste » redistribution du bien social entre individus privés, mais produire les possibilités pour que les gens eux-mêmes s’engagent dans la création de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes, en incluant la satisfaction de ses propres besoins, le « protagonisme » dans la prise et l’exécution de décisions sociales, et en général donner du sens à sa propre vie. Comme le disait Cornelius Castoriadis, une société juste est celle où la question de la justice se trouve ouverte en permanence.
La métaphore de la Casa Cuba nous renvoie à un idéal de réconciliation. Le message évangélique enseigne que la réconciliation avec soi-même est impossible sans la réconciliation avec son prochain. L’histoire des grandes révolutions nous enseigne que le rapt de l’autonomie des « masses » (j’utilise le terme à dessein) par une élite ankylosante qui concentre tout le pouvoir entre ses mains transforme la trajectoire historique du processus en « chronique d’une mort annoncée ». Par conséquent, la réconciliation de la révolution avec elle-même (ce qu’on a coutume d’appeler « autocritique ») est impossible sans une réconciliation de cette élite avec les principes radicaux qui donnèrent origine au processus (principes qui supposent, bien évidemment, qu’on cessera d’être une élite). Le respect pour le prochain dans les quartiers et sur les lieux de travail, la cohabitation dotée de sens, tout cela n’est possible que si les espaces de décision sont les mêmes espaces où il y a cohabitation : ceux qui décident de tout dans chaque pièce et dans la maison entière sont ceux-là mêmes qui y habitent (31).
Ainsi, l’architecture souhaitable de notre Casa Cuba n’admet pas de distinctions entre les chambres pour les maîtres et les chambres pour les domestiques. L’espace politique (où on prend et où on exécute les décisions, avec la dose légitime de remise en cause radicale que le terme « politique » renferme) coïncide alors avec l’espace de socialisation (où les gens naissent, où ils sont élevés, éduqués et où ils cohabitent, dans leurs moments heureux et difficiles, où s’élaborent les sens de la vie elle-même, etc. : un point de départ et d’arrivée des aventures personnelles, l’idée de foyer dans sa signification la plus émouvante). Voilà la plus belle réconciliation à laquelle nous pouvons aspirer.
Nous avons exploré la versatilité d’une belle métaphore, juste à partir de ce point où convergent un processus de révolution et un processus de réconciliation. Un point d’attraction de l’espace-temps social qui, en tant que tel, a le pouvoir d’organiser à partir de l’imaginaire les trajectoires complexes des processus historiques.
Un point de l’espace-temps social qui porte la menace de la ruine, du retour des vieux fantasmes de la discorde civile, etc., mais qui, à cause de ce même état-limite, nous appelle à l’exercice de l’espérance. Est-ce que ce sera une espérance-tentation, comme dans le mythe de Prométhée, ou une espérance-rédemption, comme dans les lettres de Paul de Tarse ? Cela ne tient qu’à nous, habitants de la Gran Casa, d’opter pour l’une ou pour l’autre.
Une maison située à l’abri des ailes de l’« ange de la jiribilla » (32) de Lezama Lima et du grand Angelus Novus, le tragique détecteur de l’Histoire, avec ses ailes écrasées par le vent, que Walter Benjamin entrevit dans ce tableau de Klee. Ils sont là tous les deux, aux deux extrêmes du plan où on aperçoit le nouveau dessin du foyer, comme ces chérubins qui veillent sur l’Arche de l’Alliance.
Dmitri Prieto Samsónov
__________________________
1. Le titre de cette chanson fait référence au quartier de La Havane, El Cerro ou Cerro tout court. « Cerro cerra’o » est la contraction populaire de « Cerro cerrado », soit « Cerro fermé ». (N.d.T.)
2. Mot formé sur « jinetera », un terme qui désigne les jeunes femmes qui, sans être des prostituées habituelles, vendent leurs charmes aux touristes. (N.d.T.)
3. Le mot « palestino » désigne, de façon péjorative, les « Orientaux », les habitants de la partie orientale de l’île, la plus « colorée » de Cuba. (N.d.T.)
4. De « fiarse », se fier de quelqu’un, lui faire confiance. Il s’agit ici du crédit dont disposent les clients fixes chez certains commerçants, de « l’ardoise », selon l’expression consacrée en France. (N.d.T.)
5. Terme proposé par Yasmín Silvia Portales Machado. 6. Je me souviens d’une expérience vécue quand je donnais des cours de « Philosophie et société » dans une Université municipale : une jeune étudiante énonça, à ma grande surprise, le suivant dictum : « Bush n’applique pas bien le marxisme. » Pour elle, il n’y avait pas d’incohérence dans le fait que Bush ne puisse pas être marxiste : le problème était qu’il n’appliquait pas correctement cette doctrine. 7. Le verbe « resolver » exprime la nécessité ressentie par la plupart des Cubains de « salir adelante », de s’en sortir par tous les moyens possibles. (N.d.T.) 8. Nom donné aux bandes de jeunes délinquants en Amérique centrale. (N.d.T.)
9. Voir supra, note 3. (N.d.T.)
10. Nuestra América est le titre d’un essai écrit par José Martí en 1891. (N.d.T.)
11. Pour Marx, l’organisation des paysans est semblable à celle « des patates dans un sac de patates ».
12. Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), écrivain et homme politique (il fut le septième président de la République argentine). Dans Facundo, son œuvre majeure, consacrée à la critique du dictateur Juan Manuel de Rosas, il opposait l’Argentine de la « civilisation » et des Lumières, celle des grandes villes, à l’Argentine de la « barbarie », celle des gauchos des campagnes les plus reculées. (N.d.T.)
13. Lequel vit dans le mir – la communauté paysanne russe – une possible base économique et éthique pour la révolution socialiste libertaire dans ce pays, mais qui fut capable en même temps de critiquer son caractère patriarcal et excluant, une donnée qui concorde avec mon argumentation postérieure.
14. Anthropologue et anarchiste nord-américain, auteur en particulier de Fragments of an Anarchist Anthropology (paru en 2004, et traduit en français sous le titre Pour une anthropologie anarchiste, en 2006, aux éditions Lux) et Debt:the first 5,000 Years.
15. Nom donné aux guérilleros cubains favorables à l’indépendance de l’île. D’après l’anthropologue cubain Fernando Ortiz, le mot proviendrait de mbi, un mot bantou, la langue d’une grande partie des esclaves noirs amenés à Cuba. (N.d.T.)
16. Mot construit sur « socio » (ami, partenaire) afin de désigner les échanges de faveurs entre « copains », principalement pour accélérer les procédures bureaucratiques, obtenir des privilèges ou avoir accès à des biens rares. Le mot est évidemment une déformation de « socialismo ». (N.d.T.)
17. Autrement dit, typiquement cubaine. (N.d.T.)
18. Membre de la confrérie Abakuá, qui en 1871 avait déjà – et ce depuis une décennie – un caractère intégrationniste, incluant en son sein tant les Noirs que les Blancs, les métis et les Asiatiques.
19. Varela, Félix, Obras, tome I, Editora Política, La Havane, 1991. [Félix Varela y Morales (1788-1853), curé au séminaire de La Havane, philosophe et politique, est tenu pour un des « pères » de la nation cubaine. (N.d.T.)]
20. Gibbon, Edward, The Decline and Fall of the Roman Empire, Wodsworth, Ware, 1998.
21. En tant que psychologue, le père Alejandro Moreno a mis en circulation l’aphorisme suivant : « Seul ce qui est affectif est effectif. »
22. D’un point de vue anthropologique parlant, ces thèses d’origine marxiste peuvent être enrichies par les très intéressantes réflexions de Kropotkine, Malatesta, Max Weber, Durkheim, Mauss, et autres, mais je préfère ne pas entrer ici dans des considérations théoriques.
23. Comme l’affirma Marcelo « Liberato » Salinas, « plus que l’amour de la patrie, fait populaire, profondément ressenti, qui n’a pas besoin des subsides de l’État pour exister, on a renforcé de plus en plus le culte de l’État qui naquit à partir de l’instrumentalisation des conquêtes populaires de la Révolution de 1959 ». (http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com/2011/08/12/respuesta-al-doctor-enrique-ubieta-de-un-anarquista-del-observatorio-critico/).
24. « Cela a lieu bien que des gens, au XIXe siècle, aient mis en garde contre les inconvénients dérivés des différences culturelles. Par exemple, Sainz de Bujanda nous rappelle ce que le journaliste et poète Carducci écrivait dans La Gazzetta dell´Emilia du 23 septembre 1893 : « En matière fiscale, et plus précisément en ce qui concerne les impôts du fonciers, les nouvelles provinces connaissaient la plus scrupuleuse honnêteté de la part des contribuables. Avec le changement de régime, les fonctionnaires italiens, après avoir remplacé les autrichiens, appliquèrent le principe de “l’incertitude systématique” en augmentant toujours les sommes déclarées. Cela produisit d’abord la stupeur des habitants de Trente et de Trieste, lesquels, trouvèrent bien vite la parade : s’habituer, hélas, à mentir, à l’instar de leurs frères des vieilles provinces du Sud. » (Del Percio, op. cit.)
25. Le fait de devenir civilisé. (N.d.T.)
26. Dans un rapport du début de ce siècle, le CIPS [en français, Centre de recherches psychologiques et sociales] apportait la preuve de ce que seuls 5 % des Cubains vivent de l’argent qui leur vient de leur salaire. Pour le mensonge dans la société cubaine, on lira le témoignage d’Amrit « La piedad de la mentira » sur le blog de l’Observatoire critique.
27. « Ne pas avoir un agenda politique personnel, c’est renoncer à faire des rêves » (blog de l’Observatoire critique).
28. Cube, film canadien de science-fiction de Vincenzo Natali (1997). (N.d.T.)
29. Voir le dossier de la revue Espacio Laical sur l’espérance.
30. Bobbio, Norberto, Tra due Repubbliche, Donzelli, Roma, 1996.
31. Ou, pour le dire en termes sociologiques, « les espaces de décision doivent coïncider avec les espaces de socialisation ».
32. Dans le parler populaire cubain, « jiribilla » a plusieurs acceptions, qui sont toujours liées à l’idée de mouvement, d’activité intense, de brio, de drôlerie, de sympathie, etc. L’ange de la « jiribilla » apparaît pour la première fois chez Lezama dans l’essai « A partir de la poesía » (recueilli dans le livre La cantidad hechizada, paru en 1970 à Cuba). Cet ange est doté des caractéristiques essentielles de l’identité culturelle cubaine, profondément métissée, capable de passer d’un registre à l’autre, du plus populaire au plus cultivé. (N.d.T.)
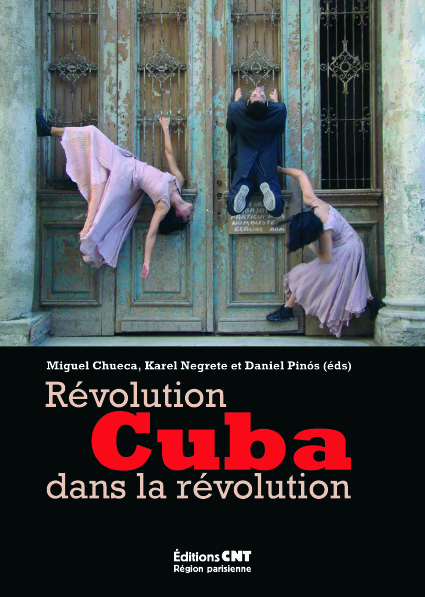 Cuba. Révolution dans la révolution
Cuba. Révolution dans la révolution
Texte extrait du livre édité par Miguel Chueca, Karel Negrete et Daniel Pinós
Cuba, révolution dans la révolution qui prolonge le livre de Frank Fernández, L’Anarchisme à Cuba, paru aux éditions CNT-RP en 2004, vise à faire connaître aux lecteurs français les divers protagonistes du mouvement contestataire cubain puisque, à côté des écrits issus de certains des soutiens dont il dispose hors de l’île, la plupart des textes recueillis ici procèdent de Cuba même, de sa gauche hétérodoxe, sociale et libertaire. Les promoteurs de ce volume n’ont pas souhaité s’en tenir au seul domaine de la réflexion politique et c’est pourquoi, outre des essais consacrés à la critique des « réformes » en cours à Cuba après l’effacement de Fidel Castro ou à l’exposition de propositions programmatiques en faveur d’un socialisme démocratique et participatif, on trouvera ici des textes relatifs aux questions du racisme et de l’homosexualité à Cuba, à la charge subversive des nouveaux courants musicaux (rap et hip-hop), à l’introduction des cultures génétiquement modifiées ou encore à l’étonnante impulsion donnée par le régime à la construction de terrains de golf pour millionnaires.
Ces textes sont dus principalement aux activistes regroupés autour de l’Observatoire critique de la Révolution cubaine, un vaste réseau qui inclut des militants de tendances diverses, socialistes d’obédience marxiste et socialistes libertaires, écologistes radicaux, etc., qui sont parvenus à coexister dans le respect de leurs différences. Malgré les difficultés inhérentes à l’existence d’un régime profondément autoritaire, les uns et les autres tentent depuis quelques années déjà de présenter une critique raisonnée du régime en place et d’oeuvrer à ce que l’après-castrisme ne ressemble pas, ou ressemble le moins possible, à ces divers « modèles » – ou plutôt « contre-modèles » – qui, en Russie, en Chine et ailleurs, ont remplacé les régimes abusivement et improprement appelés « communistes » par les porte-parole de l’ordre (capitaliste) établi.
Éditions CNT-RP
328 pages, 18 €
ISBN 978-2-915731-31-4

